A quoi résiste la psychanalyse ?
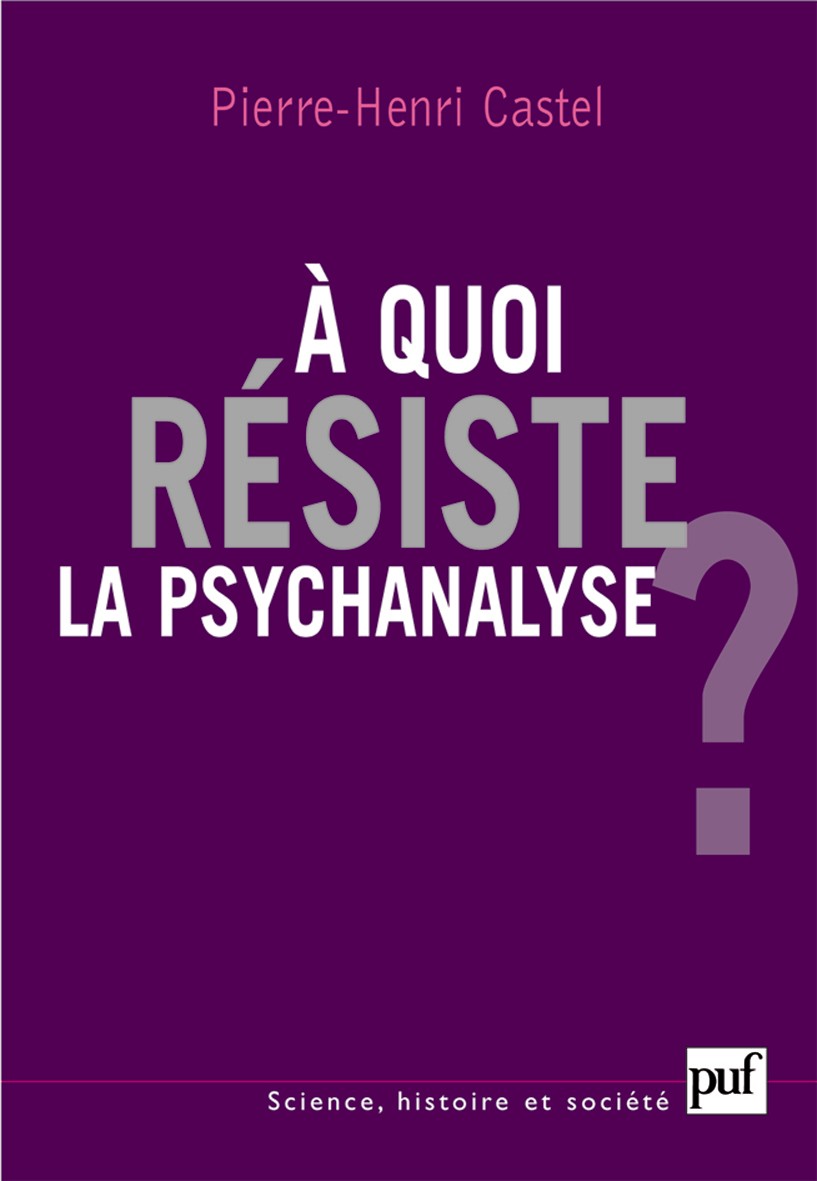
(Pour une brève présentation
du livre, voir l'interview
d'Alain Bellet sur le site Freud-Lacan.com
ou le résumé
sur le site de la SPP).
![]()
Introduction
Ce bref essai s’adresse moins aux psychanalystes ou à leurs patients, qu’à
un public un peu particulier, mais néanmoins de plus en plus nombreux :
ceux qui se demandent comment, aujourd’hui, on peut bien vouloir entreprendre
une cure, voire devenir psychanalyste. Quel crédit, en somme, la psychanalyse
conserve-t-elle pour que des gens pas tout à fait ignorants ni naïfs, dont
on ne suspecte pas non plus a priori l’avidité ou même la crapulerie,
continuent avec une certaine modestie (j’y reviendrai) à s’y consacrer ?
Car de telles questions, sauf à se boucher farouchement les oreilles, se posent,
et sont même fort directement posées dans le contexte contemporain, non seulement
dans des écrits de semi-vulgarisation livrés au
public avec force publicité, mais aussi dans les sphères médicales ou dans
la recherche critique la plus sophistiquée.
Comme je ne viens pas seulement de la psychanalyse, mais
aussi de l’histoire et de la philosophie des sciences, on me permettra d’introduire
mon sujet par des considérations sur la chronologie de ce questionnement sceptique,
voire virulent et dénonciateur, de risquer un état des lieux intellectuel
de la psychanalyse, et d’en tirer un tableau d’ensemble aux couleurs un peu
crues, mais dont j’entends faire ma base de départ.
Car les années 80 semblent avoir constitué un tournant crucial,
et tourné la page d’une phase de domination quasi-exclusive du paradigme freudien
dans l’espace intermédiaire, mi-scientifique mi-culturel, où nous définissons
ce qu’est pour nous « aller mal », « avoir des symptômes »,
« souffrir psychiquement », etc.
En 1979 décède en effet Wilfred
Ruprecht Bion ; en 1980, Erich Fromm ;
en 1981, Jacques Lacan et Heinz Kohut ; en
1982, Anna Freud. Cinq psychanalystes disparaissent, mais aussi, et c’est
un symbole, cinq des plus grands noms de la psychanalyse après Freud. En 1980
également, l’American Psychiatric Association
fait paraître une version révisée (c’est la troisième) de son Manuel Diagnostique
et Statistique des Troubles Mentaux. Rédigé par une pléiade de psychiatres
tous, à une ou deux exceptions près, officiellement formés à la psychanalyse,
il renonce désormais à toute hypothèse causale pour décrire et pour classer
les pathologies psychiatriques. Ainsi, ce manuel, cité en général par l’acronyme
anglais DSM-III, liquidait-il dans la pratique de la psychiatrie scientifique
la référence jusque là mieux que préservée, carrément dominante, aux catégories
freudiennes. Première victime : la notion de névrose, laquelle ne survit
plus désormais, à titre d’exception politiquement négociée par les vétérans
du Vietnam, que dans l’entité du « stress post-traumatique ». Car
là, comme le nom l’indique, l’étiologie avait bien dû servir de critère… Névrose,
certes, n’est aussi qu’un nom. Mais nul ne s’y est trompé : le DSM-III,
en renvoyant ce nom au passé, ou bien plus astucieusement, à la préhistoire
de la psychiatrie future, donnait un coup mortel à l’évidence régnante que
les troubles mentaux devaient à la fois se décrire et s’expliquer d’un point
de vue « psychodynamique », autrement
dit, consister en phénomènes inscrits dans des relations à autrui, et dans
une histoire profonde dépassant l’objectivité brute des symptômes et leur
conscience actuelles chez le malade. Et sans névrose entendue en ce sens minimal,
bien sûr, plus de psychanalyse
[1]
.
Remontant 25 ans en arrière, j’aimerais surtout rendre sensible
ceci : affirmer que la psychanalyse, dans tous les pays et dans toutes
ses variantes cliniques et théoriques, traverse aujourd’hui une crise
majeure, peut-être terminale, n’est nullement une exagération née d’un manque
de recul. Le recul est là (en gros, le quart de la vie de la discipline elle-même),
et le constat sans équivoque. Car depuis 25 ans, tant le prestige scientifique,
voire tout simplement intellectuel, que clinique et thérapeutique, sans oublier
le pouvoir d’attraction culturelle de la psychanalyse, ont fondu comme neige
au soleil. Etrangement, la gravité de la crise n’est guère sensible aux psychanalystes
eux-mêmes : ils forment en effet depuis les années 60 un milieu professionnel
qui s’isole, pour des raisons à discuter, telle une élite au cœur de la nébuleuse
contemporaine des métiers psychologiques que les sociétés développées ont
fait proliférer à diverses fins, et ces métiers, ainsi que les formations
qui y conduisent, continuent à lui rendre un culte révérencieux. Au sein donc
des sociétés de psychanalystes, on se coopte, on discute, on publie, et même,
parfois, on se cite. Mais c’est là une vitalité en vase clos ; il suffit
de comparer les revues de psychanalyse, de sciences humaines et de psychiatrie
des années 60 à leurs héritières actuelles pour mesurer l’ampleur des dialogues
rompus et des ignorances insoucieuses. Certes, ce n’est pas en France, ni
en Argentine, qu’on trouvera les signes les plus douloureux de la désaffection
dont je parle. En revanche, partout où ne subsiste que sa dépouille idéologique,
le freudisme, celui-ci ne suscite plus que sarcasmes. Enfin, il serait trompeur
de croire que la langue et la vie de tous les jours, en incorporant tant d’expressions
freudiennes dans la justification de nos attitudes psychologiques (Untel « refoule »,
« dénie », et pensez aux nuances « hystériques » qu’on
sait si bien détecter dans la sexualité ou l’agressivité d’autrui), prouvent
par là le caractère acquis, voire indéracinable du savoir freudien :
« If often he was
wrong and, at
times, absurd,/ to us
he is no more a person / now but a whole climate of opinion / under whom we conduct
our different lives », écrivait ainsi Auden
[2]
à l’ombre géante de Freud… Las, s’il est vrai que
la psychanalyse entretient des rapports conceptuellement décisifs avec la
psychologie ordinaire (i.e. non-objectivée
par des procédés scientifiques), elle y introduit aussi un ordre de rationalité
qui exige un peu plus que l’impression d’être freudien en parlant de l’hystérie
ou du refoulement à l’œuvre chez tel ou tel. Et là, les choses se gâtent,
car c’est précisément cette rationalité, autrement dit l’extension audacieuse
par Freud des concepts ordinaires de la conscience, de la culpabilité, du
désir, de la mémoire, extension qui les métamorphose et leur confère une texture
nouvelle et inouïe — c’est cette rationalité qui est devenue proprement inintelligible.
Depuis 25 ans, la crédibilité de la psychanalyse paraît donc s’être effondrée
pour plusieurs raisons, tant internes (stérilité de l’invention clinique comme
théorique, orthodoxies ressassées, vices de la transmission), qu’externes
(nouveaux paradigmes en psychologie, mutations des attentes culturelles, voire
de certains rapports sociaux cruciaux, virulence et publicité, enfin, des
réfutations historiques et épistémologiques de Freud et de son héritage, etc.).
L’idée centrale du présent essai est qu’on pourra difficilement désintriquer
ces facteurs : ils ne sont jamais purement théoriques ni purement sociologiques,
mais au contraire, et c’est leur intérêt, tout cela à la fois. On peut d’ailleurs
voir ce qu’on veut dans la crise en cours : le triomphe d’une vérité
longtemps bafouée par les freudiens, les prémices d’une catastrophe psychique
collective, la vérification du caractère culturellement inassimilable de la
psychanalyse, ou, tout bêtement, la clôture d’une parenthèse non-scientifique
regrettable ; c’est affaire de goût, d’intérêts ou de moyens. L’important
est d’abord d’avouer que la psychanalyse en est ressortie en guenilles.
Or, si l’on ne résiste, en un sens, qu’à ce qui est pleinement
irrésistible (car sinon, on ne résiste pas vraiment, on continue juste d’exister
sans réelle tension, l’agression subie était encore marginale), alors il faut
s’adresser frontalement à ces facteurs de crise, dans ce qu’ils ont de plus
massifs, et sans doute de plus désespérants.
Voilà l’enjeu — mais aussi, pour des motifs que je vais
bientôt détailler, l’opportunité paradoxale qu’il offre.
*
Car à quoi résiste la psychanalyse ?
A mon avis, à trois choses : 1. à une critique épistémologico-historique assez originale et plutôt bien informée,
qui, croit-on, l’a finalement laissée pour morte (Outre-Atlantique,
elle a donné lieu à un déchaînement polémique qui a atteint le grand public :
les Freud Wars) ; 2. ensuite, plus subtilement (et c’est le cœur de mon propos),
à elle-même, autrement dit à ce qu’elle déploie de plus psychanalytique,
et qui, étant radicalement dérangeant pour tout savoir et pour toute motivation
habituelle des actes, l’est aussi pour la psychanalyse ; 3. enfin (et
je m’extrais là du précédent paradoxe), elle résiste à l’exaltation de valeurs
dont la civilisation (Kultur, disait Freud)
a fait des idéaux fondateurs de la vie commune, au point que leur mise en
cause continue à faire de la psychanalyse un sujet de scandale — simplement,
ces idéaux ne sont plus la conscience, ni la supériorité de l’esprit sur les
bas instincts, comme aux débuts du freudisme, mais ceux de l’autonomie individuelle
(surtout en matière de « choix sexuel ») et de son corrélat, la
subjectivité, cet abri sacré de la différence entre mon moi et le vôtre.
On le voit, résister n’est pas pris au même sens dans chacune
de ces entrées. Mon plan de bataille, que je vais livrer, tente d’ailleurs
à chaque moment d’articuler un certain contenu de l’idée de résistance et
un type particulier d’adversité encourue par la psychanalyse, en sorte que
le lecteur sente combien la psychanalyse n’est pas juste attaquée de tous
côtés (y compris de l’intérieur d’elle-même), mais fait problème loin au-delà
de son cercle propre — et parce qu’elle met peut-être au jour la solidarité
méconnue des attaques qu’elle subit, elle inquiète les points d’appui
ultimes de nos manières ordinaires de vivre et de penser.
Le premier chapitre s’interrogera donc sur la capacité de
la psychanalyse, au niveau de ses concepts et de ses hypothèses fondamentales,
à résister par des contre-arguments aux arguments
soulevés récemment contre elle, par la philosophie des sciences, d’une part,
et de l’autre, par la critique historique. On dira : c’est un peu raide…
Faut-il vraiment introduire le lecteur, même curieux et de bonne volonté,
dans les méandres extrêmement sophistiqués de la philosophie de la psychanalyse
et de la critique historiographique, et plus sérieux encore, faire d’un juste
saisie de ce qui s’y passe un préalable pour comprendre le reste ? A
mon avis, oui. Un des effets les plus dommageables de la déchéance intellectuelle
de la psychanalyse, c’est le sentiment très répandu désormais dans le public
cultivé qu’elle n’aurait rien à répondre, finalement, aux avis des « experts »
qui la condamnent comme une pseudo-science mâtinée
d’imposture. Assurément, les excellentes raisons qu’on a de n’être en rien
du tout intimidé par les déclarations bruyantes de tel ou tel ne sont pas
si faciles à faire valoir. Avec un peu de neurobiologie vulgarisée
(de belles images multicolores du cerveau, par exemple), diverses statistiques
et un appel à être de son temps, on fait merveille. L’ignorance crasse des
enjeux et des outils contemporains de la critique théorique fait le reste
chez les psychanalystes les mieux intentionnés. La confusion régnante entre
rationalité et scientificité est telle, que la peur de n’avoir rien à opposer
aux attaques récentes contre la psychanalyse-comme-science
a pour conséquence une fuite dans la philologie et « l’éthique »
qui enferme toujours davantage le milieu psychanalytique dans son isolat socio-culturel, tandis qu’on en vient à regarder avec méfiance
toute tentative de justifier en raison la démarche psychanalytique
— et la raison est commune, c’est autant la mienne que la vôtre. Or il tout
à fait naïf de croire que si un savoir n’est pas scientifique (et la psychanalyse
n’est pas une science, du moins au sens actuellement reçu du mot), on pourrait
en dire ou en faire n’importe quoi : c’est donc le type de contraintes,
logiques ou conceptuelles, disons, qui s’exercent sur elle, que je mettrai
plus loin en avant.
Pour des raisons de qualité intrinsèque comme de notoriété,
je m’intéresserai surtout aux travaux d’Adolf Grünbaum et de Mikkel Borch-Jacobsen. Et je crois pouvoir d’emblée annoncer
pourquoi je tiens leurs « réfutations » pour beaucoup moins réfutatives qu’on ne l’a dit. La première raison consiste
à pointer diverses inconsistances exégétiques ou logiques de ces approches
anti-freudiennes ; car il y en a, et elles ne sont pas si complexes à
comprendre, même pour un lecteur peu féru d’épistémologie. La seconde, qui
leur rend en même temps mieux justice, consiste à mieux dégager quelle genre
de science, par exemple, on voulait que soit la psychanalyse, pour, dans un
second temps, démontrer qu’elle n’en est justement pas une. De façon symétrique,
quelle conception de l’histoire mobilise-t-on, pour réussir à faire l’histoire
de ce qui n’aurait été depuis les origines qu’une fraude, mais une fraude
soutenue par une illusion curieuse, puisqu’elle paraît reproduire incurablement
ses effets génération après génération d’analystes ? La psychanalyse,
pour le dire vite, peut-elle « résister » à ces deux critiques,
poussées à leur point d’incandescence par les auteurs que j’ai cités, selon
lesquels : 1. elle échoue à fournir une théorie recevable de la causalité
des faits mentaux ; et 2. elle n’est
qu’une variété de psychothérapie par la suggestion, mais qui, niant
farouchement en être une, se condamne à une vaine et frauduleuse fuite en
avant.
Ces objections ont de vastes effets politico-institutionnels :
elles engagent le crédit des praticiens au moment où les pouvoirs publics
s’intéressent à la santé mentale, elles jouent le rôle de faire-valoir savant
sur le nouveau marché des psychothérapies, elles permettent aussi aux idéologies
diverses qui exploitent à leur profit le développement des sciences cognitives
de « triompher d’un mythe », avec une plus-value idéologique garantie.
Dans le second chapitre, je propose une manière un peu contournée,
c’est vrai, mais dont j’espère qu’à la fin le lecteur l’aura trouvé plus parlante,
de soutenir une opinion banale : répondre aux critiques de la psychanalyse
venant de l’extérieur ne la dispense aucunement de s’expliquer avec elle-même.
En un mot, j’aimerais dissoudre l’union stérile des critiques mal ciblées
et des vaines apologies en transportant le débat au cœur même de la psychanalyse.
Pour cela, donc, je ferai jouer autrement la lumière dans
le prisme de la « résistance ». Car ce mot, comme on sait, est un
concept de Freud. La résistance, au premier chef, est le fait clinique manifeste
dont la raison d’être inconsciente est le refoulement : le patient, approchant
dans ses associations du noyau de représentations pathogènes refoulées qui
détermine sa névrose, connaît des « blancs », et vit des états où
« il ne sait plus », « il n’a plus rien à dire ». Voilà
la résistance. Un élément décisif pour l’apprécier et, éventuellement, la
surmonter consiste en ce point à se demander devant qui, voire contre qui le
patient fait l’expérience de tels blancs — ce qui met en cause le transfert
sur l’analyste. Seule l’analyse des résistances et surtout des résistances
dites « de transfert » permet, énonce la doctrine, la liaison des
contenus refoulés avec la conscience, et, à l’occasion, un meilleur ajustement.
Mais il y a aussi des résistances armées, autrement plus délicates à manier,
où le patient dûment mis en face d’un contenu refoulé s’oppose à l’interprétation
de l’analyste. A ce type de résistance se rattache la plus globale, autrement
dit, la résistance à la psychanalyse elle-même, qui est de règle dans toute
cure. Car Freud en a élargi la notion à la résistance non seulement à la psychanalyse
en tant que théorie supposée du psychanalyste dont on rejette telle interprétation,
mais à la psychanalyse en tant que corps de doctrine, dont le contenu offensant
(elle réfute le privilège de la conscience, pose le primat du désir sexuel,
etc.) déclenche, même hors-transfert, une résistance
qui s’affuble de prétentions scientifico-critiques.
On sait le sort que Karl Popper a fait à ce tour freudien : la psychanalyse
a inventé par là, dit-il, un moyen de réfuter a priori toute hypothèse
contraire, parce que vouloir en soutenir une, c’est « résister à la psychanalyse »,
c’est donc faire la preuve qu’on est sous l’empire d’un contenu refoulé, et
par là, c’est confirmer le bien-fondé … de la théorie à laquelle on croyait
s’opposer ! Toutefois, on oublie le complément à la doctrine de la résistance
qu’a également soutenu Freud. On peut autant résister par un refus de la théorie
psychanalytique, que par une acceptation trop rapide : le oui
de l’analysé, en tant que tel, n’a pas plus de valeur que son non
[3]
. Et de fait, l’argument poppérien réduit l’articulation
résistance/refoulement à un enchaînement logico-verbal,
en négligeant la dynamique psychique qu’il est censé dépeindre. Or cette dynamique
n’est en rien triviale. Disons qu’aux yeux de Freud, l’assimilation effective
et efficace d’une interprétation est un travail de perlaboration (Durcharbeitung)
dont le rythme, la conflictualité et l’élément de surprise dépassant les attentes
conscientes, mieux, comme surconfirmation inattendue,
sont incontournables ; sans ces critères, soit l’interprétation est incorrecte,
soit la perlaboration est inachevée. Ceci s’étend à la « résistance à
la psychanalyse » : tout ce qui tend si peu que ce soit à éliminer
dans l’acceptation d’une idée psychanalytique le temps qu’il faut pour se
l’approprier, les conflits qu’elle engendre entre représentations connexes,
mais aussi l’étonnement devant sa pertinence en un point précis et imprévu,
indique une résistance à cette idée.
Mais alors, et voilà le paradoxe, la théorie psychanalytique
est soumise à une tension étrange : en tant que théorie, elle
requiert une validité en tout temps, l’élimination des contradictions, et
la réduction des surprises dans les prédictions, ce en quoi, à suivre Freud,
elle ne peut que véhiculer la résistance… à elle-même ! Nul doute d’ailleurs
que l’œuvre de Freud suive un tel cours rempli de surprises et de décrochages
soudains. Son développement était, en effet, au début, fonction des à-coups
de son « auto-analyse », et s’est poursuivi dans une correspondance
très riche où il est facile de détecter un labeur fécond d’auto-critique psychanalytique de la psychanalyse. On en tire
moins, car elles gênent, les conséquences pour la psychanalyse d’après Freud :
un cours si longtemps contradictoire pourrait lui conférer, bizarrement, sa
relative garantie d’authenticité. On tire d’autant moins ces conséquences
que le concept de refoulement, s’enrichissant, a fini par culminer dans l’idée
que l’inconscient n’est pas juste un lieu où les représentations incompatibles
sont rejetées ; c’est aussi un lieu qui les attire positivement. Mais
comme le refoulement est la raison d’être de la résistance, on en vient alors
à poser un lieu de résistance interne, redoublée et par là, définitivement
inconsciente à toute levée « ultime » des refoulements. Ça résistera
toujours. Freud a donc conçu une « résistance inconsciente » comme
terme indépassable de sa doctrine, et ce, dans le mouvement psychique même
par quoi on se l’approprie. Pareille tâche, du coup, est non pas infinie,
mais indéfiniment ouverte. Accepter trop vite et sans résistance telle
ou telle conception psychanalytique, croire qu’on en dispose d’emblée pour
juger cliniquement d’un cas ou parer à une objection d’un adversaire de la
psychanalyse, c’est alors la preuve que rien, ou si peu, n’a été correctement
assimilé et approprié ― ou qu’on brasse juste des idées, ce qui n’est
nullement penser.
Pourquoi cette clarification ?
Parce qu’il ne suffira jamais de parler de la résistance
de la psychanalyse à ses adversaires, sans parler des résistances à
la psychanalyse ; mais, entraîné sur ce fort mouvant terrain, il faudra
aussi évoquer les résistances de la psychanalyse à elle-même : à
ses manières de se penser, de se justifier, d’opérer, qui la mettent elle-même
en cause. Car ces résistances-là dérivent du maître-concept
de Freud, l’inconscient. En tout cas, argumenterai-je, si étrange qu’il paraisse,
ce paradoxe concentre concrètement les conflits qui ont déchiré le mouvement
psychanalytique et qui sont devenus aujourd’hui paroxystiques.
Où en sommes nous, en effet ?
Vue du dedans, et pour le praticien que je suis, la psychanalyse
se déchire aujourd’hui entre deux tendances irréconciliables.
La première, néo-positiviste d’inspiration, veut la réhabilitation
scientifique de la discipline. A ses yeux, cela passe au moins par la fondation
d’une véritable « psychologie psychanalytique », et comme il faut
vivre avec son temps, par une liaison substantielle de la psychanalyse aux
neurosciences, sous le chef de la « neuropsychanalyse ». La seconde,
tout à l’opposé, recherche activement, au nom d’une empathie vantée comme
la panacée, la dissolution des asymétries structurantes de la cure, et surtout
celles du transfert, comme celles de l’inconscient au sens radicalement « résistant »
exposé plus haut. Poussant à son comble la dialectique du transfert et du
contre-transfert (réduit à la focalisation de la cure sur les réactions de
l’analyste aux réactions du patient), est alors né « l’intersubjectivisme »,
lequel, au dernier pointage, serait devenu le courant aujourd’hui dominant
en Amérique du Nord. Je donnerai là-dessus tous les détails. Mais d’entrée
de jeu, je veux soutenir que cet écartèlement, qui fait fortement douter qu’il
existe encore quoi que ce soit comme « la » psychanalyse, dérive,
et dérive à mon avis originairement, de la difficulté que la psychanalyse
se pose à elle-même en se résistant. La raison, au fond, en est assez
intuitive
[4]
. Car de deux choses l’une : soit on fuit l’attitude
psychanalytique juste à l’égard de l’appropriation des concepts (par la perlaboration)
dans un recours aux théories dont les sciences sont le paradigme — auquel
cas, la psychanalyse est une variété de psychologie, avec juste des objets
et une clinique « à part », et à une théorie pareille, plus question
de « résister » subjectivement, car on la domine sans expérience
ni renouvellement intimes ; soit, à l’inverse, on s’enfonce corps et
biens dans les échanges du patient et de l’analyste en tant que pure relation
empathique ― mais aussitôt, le renversement toujours potentiel des rôles
ouvre un espace de pure et simple réciprocité où la transparence et la reconnaissance,
soit les valeurs de la conscience et du moi, imposent subrepticement leurs
normes. Considérant que le seul espoir de légitimité de la psychanalyse est
de l’inscrire dans le cadre des sciences, la psychologie psychanalytique (et,
à l’extrême, la neuropsychanalyse), consomme la liquidation de sa subjectivation.
On n’y dit plus je, au mieux, on parle du je. Sonnant au contraire le glas
de l’asymétrie dans le transfert, l’intersubjectivisme liquide l’inconscient, qui n’est plus,
asymptotiquement, que ce que je n’ai pas encore (re-)trouvé de moi dans l’autre
[5]
.
Bien sûr, errants entre ces gouffres, il y a toute la cohue
inquiète des éclectiques, dont la lecture fait le charme de l’abonné aux revues
professionnelles. Un œil philosophique s’alarme cependant du grand nombre
de fausses fenêtres par lesquelles d’excellents esprits espèrent trouver leur
salut. Par exemple, il serait naïf de croire que la faute de ceux qui veulent
défendre la scientificité de la psychanalyse est de s’appuyer sur la neurobiologie.
Ce serait aussi vain avec la linguistique, l’ethnologie de la parenté ou les
mathématiques. Du simple fait que ces savoirs se maîtrisent sans nul processus
d’appropriation subjective, on n’y résiste pas plus au sens freudien, et ils
ne fournissent pas le genre de savoir dont Freud fait le pari. De même, l’asymétrie
transférentielle, condition de la mise en cause des illusions de la conscience,
est une bien belle chose, mais elle ne se décrète pas. Ce qui veut dire qu’il
n’existe aucune méthode a priori pour l’instaurer, ni la position allongée,
assise ou à genoux, ni le silence systématique, ni la conversation cordiale,
pas même le minutage des séances. Le « cadre », comme on dit, n’est
cependant pas ployable à toutes les fantaisies, dans la mesure où il doit
tenir compte, précisément, des résistances au processus de la cure, et qu’il
ne peut que s’appuyer contre elles afin qu’elles soient, dans une certaine
mesure, surmontées.
C’est pourquoi surgissent là deux problèmes qui ont divisé
jusqu’au schisme la communauté analytique, au moins depuis les années 60.
Le premier est de savoir comment transmettre l’expérience psychanalytique,
tant il est clair que cette expérience ne peut être ni tout à fait ineffable,
réduite au colloque singulier du candidat avec son didacticien, ni un examen
de compétences sur la doctrine, ni la synthèse de ces deux impasses. Le second,
c’est de savoir jusqu’où s’étendent, comme on les appelle d’un mot de médecin,
les « indications de la cure », mais aussi les modifications de
la technique qui font qu’on a encore affaire à une psychanalyse, et pas à
une vague psychothérapie, ou à moins encore. On ne peut imaginer de développement
de la psychanalyse qui nie ces écueils, mais faute de savoir les éviter, c’est
sur eux que se brisent continuellement les meilleurs vaisseaux.
Enfin, je propose d’ouvrir, en déclinant les valeurs du
mot « résistance », un troisième front. Dès l’origine, et parce
qu’elle se fonde sur l’idée qu’il y a quelque chose que les êtres humains
ne veulent surtout pas savoir mais qu’ils refoulent, la psychanalyse s’est
conçue comme une attitude critique à l’égard du monde social, déclenchant
forcément des réactions de rejet. Très tôt dans le mouvement analytique, il
y a donc eu une « gauche freudienne », aux sympathies marxistes
connues (de Fenichel à Reich). Force est de constater que cette présence politique
subversive de la psychanalyse à notre vie sociale a quasiment disparu. On
doit au contraire prendre la mesure de ce qui se passe, quand les notions
freudiennes sont invoquées non plus pour résister aux conformismes moraux
en matière familiale et sexuelle, mais, à l’opposé, pour étayer un propos
de facture traditionnelle, et même traditionaliste, sinon anti-moderne. Ce
à quoi il faudrait résister, désormais, et une littérature surabondante enrégimente
désormais Freud et Lacan dans cette tâche salutaire, ce serait aux effets
délétères de l’hédonisme de l’individu contemporain. Nous nous
serions sexuellement libérés bien au-delà des normes permises par la doctrine,
et nous retrouverions finalement menacés d’une autodestruction dont diverses
pathologies mentales nouvelles, pensées comme de véritables mutations psychiques,
sont les signes avant-coureurs. Les bases cliniques de ce genre de jugements
sont dérisoires. Ce qui l’est moins, c’est la prétention nouvelle de la psychanalyse
à assurer sa survie en entrant sur le marché des valeurs, et à y dispenser
des conseils en capitalisant sur son prestige ancien — ruinant par là, d’une
façon à mon avis tragique, la position d’exception si difficilement conquise
qu’elle gardait à l’égard de tout ce tohu-bohu. La pauvreté de ses innovations
propres et l’indifférence en partie méritée dans laquelle le monde savant
accueille aujourd’hui ses contributions jouent là assurément un rôle. S’est
ainsi développée une pseudo-sociologie de psychanalystes,
avatar modernisé quant aux objets de la psychologie des masses de Freud, qui
prétend éclairer à partir de la notion psychanalytique de sujet la crise de
l’individualisme dans les sociétés développées. Lui fait d’ailleurs pendant
une fausse récupération libertaire, aussi post-moderne et foucaldienne qu’on
puisse souhaiter, qui appelle de son côté la psychanalyse à liquider les vieilleries
normativantes dont elle est imbue, et qui se réjouirait
plutôt de ce qui épouvantait tout à l’heure nos anti-modernes : la banalité
désormais acquise de ce qu’on appelait, dans les âges obscurs, la « perversion ».
Or, comment cet éloge de la liberté du désir peut-il revenir à autre chose,
malgré force références à Freud et Lacan, qu’à une réhabilitation maximalement
résistante du bon vieux moi ? Mystère.
Ce nouveau jugement psychanalytique sur la vie sociale et
les idéologies du moment n’est pas une excroissance culturelle transitoire.
Elle est directement liée aux difficultés à la fois épistémologiques et cliniques
de la psychanalyse ― dont j’aurai tenté de donner un bref aperçu. Dans
sa médiocrité presque universelle, ce jugement se substitue aux réponses à
inventer, et pour le dire en peu de mot, ce désamour de la psychanalyse pour
ce qui est pourtant son monde ressemble à ce que Lisette pense d’Arlequin :
il ne voudrait pas de moi ? Mais c’est moi qui ne veux pas de lui !
Mais cela, bien sûr, ne dispense personne d’examiner sous quelles contraintes
puissantes, institutionnelles, politiques, matérielles, la psychanalyse a
évolué, au moins en France, dans cette direction. Qu’en est-il, ainsi, aujourd’hui,
du paysage de ce qu’on appelle « santé mentale » (ce nouvel enjeu
des politiques de santé publique dans les pays développés) ? En si peu
de pages, je n’ai pas la prétention de répondre. Mais il est à mon avis essentiel
de repérer certains reliefs dominants de ce paysage si l’on ne veut ni frémir
d’horreur devant des dangers imaginaires, comme je ne sais quelle montée prétendument
irrésistible et nouvelle d’un scientisme désubjectivant,
voire totalitaire, ni non plus négliger le poids à moyen terme de facteurs
économiques et politiques idéologiquement moins bruyants, empiriquement plus
compliqués à isoler, mais assez inquiétants.
C’est l’endroit où souligner l’obliquité de ma démarche.
Je suis las de ces énoncés positifs sur ce qu’est ou
devrait être ceci ou cela en matières psychanalytiques. Le choix d’une étude
philosophique n’a ici pas d’autres motifs : ce qu’est ou sera la psychanalyse,
les gens le décident très bien par eux-mêmes, et ils s’en portent comme il
leur plaît ; en revanche, ce que n’est sûrement pas la démarche freudienne,
ce qu’il ne sert de rien d’y critiquer ou d’y réfuter parce que ça n’y est
tout simplement pas, de quels espoirs, consolations ou anathèmes elle se soucie
comme d’une guigne, voilà le point
[6]
. Si ce qui suit pouvait contribuer à jeter un peu
de clarté sur les enjeux que véhiculent les polémiques anti-psychanalytiques,
mais aussi intra-psychanalytiques, j’aurais atteint
mon but. Je jugerai même avec joie l’avoir un peu dépassé, si le lecteur,
à qui, je le répète, nulle expérience de la cure freudienne n’est demandé,
mesure in fine qu’il se joue dans la résistance de la psychanalyse
quelque chose qui est, en un sens, plus important qu’elle, qui la déborde
de tous côtés et qui constitue l’espace légitime de ses futures transformations :
que les individus puissent continuer à considérer leurs crises intimes non
pas uniquement comme des anormalités à réduire à tout prix, mais aussi, parfois,
comme des moments de vérité.
Car sur ce point, la dialectique même du concept de résistance
vient à notre secours ; souffrance, il est aussi source d’un avenir possible.
Je veux terminer là-dessus. Traiter la crise comme une promesse inscrite
au cœur du projet freudien, c’est en effet se donner les moyens de la considérer
sans pessimisme si l’on est freudien, ou sans croire la cause entendue si
on ne l’est pas. Car je regarde ces assauts comme une opportunité inouïe de
renouer avec l’adversité féconde des commencements de la psychanalyse. Dépouillée
de ses formes dogmatiques, et, je dirais, heureusement rejetée par tout ce
qu’elle nous a appris à désidéaliser, la psychanalyse
n’a pas grand-chose à regretter. Il suffit pour cela de prolonger d’un pas
le paradoxe que j’ai esquissé, et de comprendre que la résistance de la psychanalyse à
elle-même est aussi son ressort intérieur, l’invitation à un travail original,
et la démonstration en acte que ce à quoi elle nous confronte n’a sûrement
pas fini de produire ses effets. Car l’histoire de la discipline l’apprend,
et me ramène à mon point de départ : qu’on ait pu dériver des idées de
Freud des conceptions et des manières de faire avec la souffrance psychique
aussi divergentes que celles de Lacan, de Bion, de Kohut
ou d’Anna Freud, sans oublier Melanie Klein et Winnicott, c’est qu’il y avait
là quelque chose = x qui donnait envie, et même férocement envie de penser
et d’agir avec audace. Pour cet x, l’inconscient
est loin d’être un mauvais terme. Il n’y a cependant pas de raison que ce
soit le seul, le meilleur, ni le dernier. Mais c’est
une autre histoire.
