la névrose obsessionnelle
5ème séance (20 janvier)
Je vais aujourd’hui lire la troisième séance de l’homme aux rats et également assez rapidement la quatrième et une partie de la cinquième, et me servir de cette lecture pour aborder trois points, trois points dont vous allez voir comment je les amène dans le cours de l’exposé, trois points essentiels, je crois.
Je voudrais d’abord essayer de tordre le cou à une interprétation récurrente que vous avez dans Hawelka, chez Mahony, que vous avez dans toute la tradition freudienne, selon laquelle il y aurait un problème avec l’homosexualité de l’homme aux rats, homosexualité inconsciente qui serait d’un type un peu particulier et qu’il faudra ici élucider. Je vais essayer de montrer la place et la fonction de cette référence constante à l’homosexualité de l’homme aux rats, dont Freud en plus, contre-transférentiellement, ne s’apercevrait pas.
La deuxième chose que je vais faire, c’est réfléchir à la manière dont après avoir théoriquement dit qu’on ne peut pas parler en termes de représentation, que ce sont des désirs, des attitudes, des souhaits, etc., Freud réintroduit la notion de représentation, et comment dans la quatrième séance, il va au point non seulement de réintroduire cette notion de représentation, mais carrément de l’offrir comme cadre de pensée à son patient, autrement dit comment il va dire à Ernst : « ce qui vous arrive, c’est que vous avez effectivement un affect d’auto-reproche qui est justifié, mais il ne porte pas sur la bonne représentation ». La dernière fois, vous vous rappelez, j’avais parlé de la conception finalement qu’a Freud de l’obsession, qui est une sorte de phobie de pensée, qui suppose la disjonction radicale de l’affect d’un côté et de la représentation de l’autre, comment il met en œuvre cette idée de disjonction comme étant véritablement le cadre qu’il propose à un moment très particulier où il veut justement rassurer l’homme aux rats, le rassurer au moment où l’homme aux rats lui raconte comment à l’enterrement d’une de ses tantes par alliance, tout d’un coup, il s’est senti débordé par une obsession épouvantable qui allait jusqu’à, dans l’au-delà, comme il le dit, supposer que son père pouvait être atteint par ses fautes.
La troisième chose que je ferai, enfin, c’est d’introduire à ce qui me paraît être une des difficultés et on peut dire même un dérapage tout à fait frappant et instructif de Freud dans cette analyse, qui est comment il va rendre compte du clivage du moi d’Ernst Lanzer, en lui disant tout en sachant que c’est une explication grossière, que « oui, la bonne et la mauvaise partie de lui-même, on pourrait les remplacer par l’inconscient infantile et le moi ». C’est là une proposition qu’il fait, qui est exactement du même ordre et théoriquement dans la continuité logique de ce qu’il vient de lui proposer sur l’affect et la représentation, et qui à nouveau a pour but de rassurer Ernst Lanzer et de le maintenir à l’intérieur du dispositif analytique.
Ce sont donc les trois grandes questions à travailler : la question de l’homosexualité, celle la grammaire de la disjonction de l’affect et de la représentation, et finalement la raison d’être de ces phénomènes de clivage.
*
Je ne vais justement pas rentrer dans l’immense et proliférant récit du circuit du remboursement impossible que Freud prend avec une minutie extrême, et qui a énormément inspiré les recherches comme celle de Mahony - qui n’a fait que reprendre toute une littérature qui existait avant lui à ce sujet -, qui essaie de se représenter la carte des lieux et les phénomènes étonnants dans lesquels il s’agit de permettre à l’un de donner l’argent à l’autre qui va rembourser le troisième qui retournera l’argent au quatrième, de façon à pouvoir obéir au vœu de rembourser le lieutenant David. Il semble, quand on voit le texte d’Hawelka, que Freud a été complètement débordé par le caractère proliférant des associations, puisque quand vous lisez les notes qu’il a prises pour la quatrième séance, à ce moment-là il écrit : « récit extrêmement long de la mort du père ». Comme c’est pratiquement le lendemain ou à deux jours d’intervalle, on a l’impression que le récit de la mort du père a probablement été aussi long, aussi complexe et aussi entortillé que celui de cette dette contractée et de toutes les solutions extraordinaires que l’homme aux rats cherche à lui donner. Il ne lui fait grâce, c’est le cas de le dire, d’aucun détail. Si bien que quand vous lisez le détail du texte, n’est-ce pas, la première question qu’on devrait se poser, c’est « comment Freud a-t-il pu supporter une pareille séance ? ». Relisez cette séance, et dites-vous que Freud essaie de suivre les méandres infinis de la chose ! Il note d’ailleurs à un moment : « un oubli de ma part », et à la fin « beaucoup est manqué parmi les beautés du cas ». C’est-à-dire qu’à un moment, on est littéralement submergé par cet espèce de flot incroyable. D’autant que ce type de séance, si vous essayez de le considérer comme un analyste contemporain, qui se dirait « au fond où suis-je devant ce torrent de propos ? », « quel est l’enjeu de toute cette histoire extrêmement détaillée ? », l’analyse contemporaine, c’est l’analyse pour qui le transfert est le cadre à l’intérieur duquel les choses s’ordonnent de façon psychanalytiquement pertinente, tandis que pour Freud, je vous le rappelle, le transfert est alors une des composantes de son traitement, et il repère donc des éléments transférentiels mais il est très loin de se situer comme nous le ferions volontiers aujourd’hui dans l’idée que tous ces éléments n’ont de sens qu’à l’intérieur du transfert, que le transfert n’est pas un des ingrédients mobilisés dans la thérapie, mais ce qui donne sens à tout ce qui est psychanalytiquement pertinent.
C’est que bien sûr le réarrangement est perpétuel, dans cette séance, et la séance elle-même fait voir devant qui Lanzer ne cesse de se justifier. Autrement dit, il étale le processus obsédant lui-même sur le transfert sur Freud. C’est frappant, et c’est je pense ce qui doit apparaître quand on lit les notes, c’est que Lanzer fait comme si il racontait ce qui lui est arrivé, alors qu’au moment où il le raconte, il vit et est sous l’empire du même type de processus que celui qu’il a vécu au moment où il a complètement déjanté dans le train, sur le champs de manœuvre, en marchant à cheval à côté du lieutenant, en courant chez Galatzer, en revenant à la gare, etc. Son récit - c’est ça le point essentiel – n’objective nullement ce qui s’est passé, mais étale et reproduit ce qui se passe dans ce type de crise épouvantable qu’il traverse. Et d’ailleurs, ça devient au fur et à mesure qu’il parle – et les notes de Hawelka sont beaucoup plus sensibles à cet égard que l’exposé un peu aseptisé du cas publié -, les notes du Journal d’une analyse le montrent bien : ça devient de plus en plus fou.
Ce qui pose toujours le problème du dosage de « jusqu’à quel point peut-on laisser raconter un rituel ou un processus obsédant ? ». C’est une question qui se pose quelquefois, parce qu’il est essentiel que ce rituel soit exposé comme ce qui vaut pour le patient, tout en se rendant bien compte qu’à mesure qu’un patient entre dans la justification des différentes figures et morceaux de son rituel ou d’une très grande obsession, comme l’obsession des rats, les effets d’affolement deviennent considérables.
Il apparaît notamment qu’il s’était caché à lui-même en racontant à Freud – c’est à ce moment-là que ça apparaît -, qu’il devait l’argent non au lieutenant David, mais au lieutenant Engel - on le sait d’après les notes d’Hawelka - qui avait payé la postière. Et un détail qui me paraît extrêmement intéressant, c’est qu’il est capable de dire – ça n’apparaît que dans le Journal -, qu’il a « rêvé » la solution de son catastrophique serment. Il a rêvé la solution, il ne l’a pas pensée, il l’a rêvé, ce qui est assez curieux quand on y pense, parce que ça montre qu’en fait le processus de sortie, de suture ou de clôture du circuit de la dette, n’est pas entièrement sous le signe de la rationalisation, mais aussi pour une part sous le signe d’une aspiration à ce que quelque chose d’autre, de radicalement inconscient, qui n’a rien à voir avec le paiement de la dette, soit mis en cause. Ce qu’il rêve est une chose très étrange : c’est d’aller avec David et Engel à la poste, de donner l’argent à David pour que David donne l’argent à la postière, à ce moment-là la postière donnera l’argent à Engel - qui a vraiment payé les lorgnons – et Engel pourra rendre l’argent à David. Donc une sorte de circuit où il donne l’argent à David, David à la postière, la postière à Engel et Engel à David. Et par là tout le monde, et c’est ça qui fait le caractère onirique, a été payé ! Il y a une remarque qui me paraît tout à fait bête, pour le dire, de Hawelka, qui veut voir là-dedans un rapport que les deux lieutenants qui sont les supérieurs de Lanzer auraient eu sous ses yeux, avec la jolie postière – à supposer que la postière soit jolie…
Je trouve plutôt que c’est un Witz. Je trouve que ça ressemble à Hirsch qui vient taper Rothschild et qui lui demande de l’argent, et Rothschild lui ayant donné de l’argent, Hirsch va s’offrir du saumon – non, je confonds deux histoires, mais je vous raconte quand même la première puisque je me suis mélangé les pinceaux. Rothschild passe donc dans la rue et voit Hirsch manger du saumon au restaurant, et lui dit « Quoi ? C’est ça que tu fais de mon argent ? », et Hirsch : « Quand je n’ai pas d’argent je ne peux pas manger de saumon, quand j’ai de l’argent je ne peux pas manger de saumon non plus, mais alors, quand est-ce que je mange du saumon, moi ? ».
Bon, ce n’est pas celle que je voulais raconter !
Celle que je voulais raconter – ça va devenir fou ! – c’est une autre, tirée de la Psychopathologie de la vie quotidienne, et si ça se trouve, c’en est une sur laquelle Lanzer est tombé avant d’aller voir Freud, car c’est quand même en lisant la Psychopathologie de la vie quotidienne qu’il choisit Freud. L’histoire est celle-ci : c’est un type qui va au restaurant, qui prend un plat avec une boisson, qui mange son plat et rend sa boisson. Le restaurateur lui dit : « mais vous n’avez pas payé votre plat ! », et le type lui répond « mais je l’ai payé en vous rendant la boisson ! ». « Mais la boisson, vous ne l’avez pas payée non plus ! », et l’autre, outré, de répondre au restaurateur : « Mais je ne l’ai pas bue ! » C’est-à-dire ce dispositif qui consiste à effacer, et qui me paraît être exactement ce qu’il y a dans ce rêve. Tout a été payé ! De quoi se plaint-on ?
C’est ça qui me paraît frappant dans ces espèces de texte dont il faut bien dire que ce sont des commentaires anti-lacaniens : le commentaire d’Hawelka est un commentaire où il s’agit surtout d’éviter toute remarque sur ce qui pourrait être de l’ordre du l’humour, du Witz, de la construction logique-paadoxale du dispositif en tant qu’elle est comique ! Il n’y a pas un seul moment où ces commentateurs rigolent sur le rêve de l’homme aux rats, qui a quand même trouvé là un moyen impayable de payer tout le monde ; et lorsqu’il se réveille, il est très content ! Alors évidemment, comme ça n’était qu’en rêve qu’il a pu payer tout le monde, après il retombe dans la catastrophe. Mais si vous faites attention, beaucoup de rêves obsessionnels produisent ce type de solution. Et on devrait s’apercevoir ici de la fonction d’humour dans la production de ce type de rêve, du trait d’esprit comme moyen au fond de résoudre en termes de jeux qui ne sont possibles qu’avec du signifiant, tout bêtement, des solutions impossibles.
Je referme ce chapitre, mais c’est ce qui me rend complètement invraisemblable la minutie du travail des Hawelka, et toute cette ambiance incroyable où il s’agit de voir de la scène primitive absolument partout, et où c’est franchement pas marrant.
Il y a deux points saillants.
D’abord, c’est parce qu’il est pris dans des impossibilités de concilier logiquement toutes ces pensées compensatoires – comment faire payer à l’un ce que l’autre doit pouvoir payer de façon à ce que, etc. – que Lanzer va voir Freud, et que là, tout s’arrête ! Vous vous rappelez, quand il va voir Freud, il va le voir pour lui demander une ordonnance qui lui permettrait de monter ce scénario invraisemblable, qui est semble-t-il celui qu’il a rêvé, et au moment où il est devant Freud, il ne lui demande pas ça ! C’est ce qui est énigmatique, alors même qu’il est venu pour l’ordonnance. La réponse de Hawelka, c’est que si Lanzer ne l’a pas demandé, c’est parce qu’il avait trouvé un nouvel objet de fixation homosexuel, en rencontrant Freud. Comment peut-on être convaincu par une explication pareille ? Vous entrez chez le psychanalyste, le psychanalyste est un homme et aussitôt vos symptômes s’arrêtent parce que vous avez trouvé un nouvel objet de fixation homosexuel ! C’est quand même extraordinaire qu’on puisse écrire des choses comme ça, il faut vraiment avoir une foi dans le déterminisme psychique et dans la théorie psychanalytique, à soulever des montagnes !
La deuxième chose, c’est que ce qu’il y a de touchant chez l’homme aux rats, c’est que, que fait-il au milieu de ses irrésistibles pensées compensatoires ? Eh bien il essaie d’assumer ses responsabilités. Ce qui est extraordinaire, c’est l’acharnement de l’homme aux rats à essayer jusqu’au bout que l’impossible soit possible. Jusqu’au bout, sur le quai de la gare, quand il se dit qu’il peut encore faire demi-tour, vus les horaires, il y a comme ça une espèce d’héroïsme dans le symptôme, qui est fort rare. Ce n’est pas n’importe quel névrosé qui est capable de pousser le bouchon aussi loin, quand même ! Il y a vraiment là un aspect des choses que les commentateurs ne soulignent pas : c’est la puissance du désir de cet homme, qui va aller porter jusqu’à la folie la contrainte à laquelle il est soumis. Et quand il est complètement submergé par les choses, que fait-il ? Il s’en remet, dit-il, au jugement de Dieu. C’est-à-dire que quand il ne peut plus trancher, la dernière chose qu’il est capable de faire c’est de suivre le premier signe que le hasard lui envoie. Le porteur lui demande s’il veut prendre le train de 10 heures, il dit « je prends le train de 10 heures ». L’autre lui aurait proposé autre chose - c’est ce que j’imagine qu’il faut comprendre -, par exemple le train de 11 heures, il aurait pris le train de 11 heures. Il ne craque qu’au moment ultime, et il s’abandonne à ce moment-là à une décision de hasard.
Ce que je trouve frappant, c’est que dans l’expérience clinique ordinaire des obsédés qui sont traditionnellement décrits, les obsédés sont plus rarement des patients qui tiennent si longtemps. L’idée qu’au fond, « je ne sais pas, le hasard va décider » est en réalité extrêmement rapide, extrêmement fréquente. Et c’est souvent ça qu’on impute à la superstition. Mais je dirai que la superstition de l’obsédé est quelque chose de complexe par rapport à cette démission qui consiste à laisser jouer le hasard. La superstition au sens où il y aurait des signes, des prémonitions et des choses comme ça, ne doit pas être confondue avec le fait qu’il y a des jugements de Dieu qui décident à ma place.
Or, je crois que ces deux points saillants de la troisième séance, sont liés. D’abord, parce que je ne crois pas du tout que ce soit la fixation homosexuelle sur Freud qui soit la clef de voûte de ce cas, et en tout cas certainement pas ce qui permet d’en examiner les détails. Parce que, qu’est-ce que Lanzer est allé chercher ? Il est allé chercher Freud parce qu’il vient de feuilleter la Psychopathologie de la vie quotidienne et qu’il a été frappé de la ressemblance entre un certain nombre de processus qu’il voit décrit, et ce qu’il vit lui-même. Donc je crois que ce qu’il est allé chercher, c’est un ordre au second degré dans ce désordre épouvantable dans lequel il n’arrive pas à se dépêtrer. Là où il suppose Freud savoir, là où s’amorce le transfert, c’est que ce qu’il vit comme un délire des rats avec la dette, est en réalité quelque chose qui pourrait avoir ailleurs une rationalité, et qui pourrait ailleurs se boucler. Je ne suis pas tout à fait sûr que ce ne soit pas justement en général sur le rêve d’une solution que l’obsédé aille voir le psychanalyste. Si cette solution est psychanalytique, très bien, si elle est cognitivo-comportementale, très bien aussi ! Le but, c’est de trouver une solution de cela même qui est vécu comme devant être absolument résolu. Que donc l’amorce fondamentale, la demande thérapeutique de l’obsédé inclut déjà le praticien comme un des éléments de la résolution d’un problème qui n’est défini que dans les termes qui obsèdent le patient.
C’est quelque chose de tout à fait singulier.
Je vous ferais remarquer d’autre part à propos de ce grand délire, que les rats, dans la troisième séance, ont totalement disparu ! Le mot n’y figure même pas, ou à peine, cette fois il n’est question que de l’argent. Mais serait-ce exagéré que de dire que c’est justement là où s’opère la véritable transformation entre les rats et l’argent ? Car qu’essaie-t-il de faire, sinon de faire circuler cet argent de manière à ce que cet objet brûlant qui doit transiter, si j’ose dire, arrive à destination ? La charge affective, la puissance horrible qui s’était fixée sur les rats semble s’être transvasée dans cet argent qu’il faut rendre à tout prix, mais à tout prix, sur un mode horrifiant et paniquant. C’est dans la façon même dont les associations et le récit se déroule que vous devez mesurer comment s’opère la transformation symbolique des rats en argent. C’est que quand ils disparaissent, le facteur d’accélération et de panique, le facteur qui rend fou dans le récit de la grande obsession du circuit de la dette, c’est les rats. On a totalement oublié que s’il ne rend pas l’argent, le père et la dame vont subir l’horrible supplice. On l’a totalement oublié, ça s’est complètement transvasé dans la question maintenant, de savoir comment ces fichus 3 couronnes 80 vont réussir à rejoindre leur point terminal. Voyez comment on pourrait facilement sombrer dans une sorte d’équivalence obscure et complètement mystificatrice, où les rats, c’est la même chose que l’argent, en objectivant les choses, sans voir justement leur mise en fonction dans l’économie transférentielle, c’est-à-dire dans le fait que c’est cette même charge affective qui est passée dans l’argent, et que c’est pour ça que l’argent et les rats sont en relation. C’est de séance en séance que ça se passe, regardez ce qui manque dans la précédente. Je crois que si on lit L’homme aux rats comme ça, c’est prodigieusement instructif. Quand d’une séance à l’autre un terme a complètement disparu, qui vous a paru d’un entretien à l’autre si incroyablement chargé de sens, pourquoi ne serait-ce pas à partir de ça qu’on établirait quelles sont les véritables équivalences symboliques, ce qui permet, dans le transfert, de maintenir la tension associative ? C’est par là qu’elle se construit. Voyez que l’éclatement imaginaire qui aboutit à cette forme de dépersonnalisation tragique de l’homme aux rats, il est dans le transfert à Freud de la tâche de faire tenir tout ça ensemble, et d’arriver à boucler la boucle, à rester cohérent, à vaincre la folie de tout ça, que ce soit par le moyen de l’ordonnance qui aurait permis de résoudre le problème ou que ce soit par le moyen d’une autre sorte d’ordonnance qui est la rédaction du cas lui-même, qui est le travail de Freud, qui va produire une rationalité de second ordre, laquelle donne au désordre apparent un ordre secret, qui va le faire apparaître, il s’agit de transférer à Freud, sur Freud, cette tâche de la mise en ordre.
Je voudrais maintenant ouvrir ma première parenthèse.
Il ne suffit pas de dire que ces explications par le transfert homosexuel de l’homme aux rats sur Freud sont cliniquement douteuses. Je crois qu’elles ne paraissent évidentes à Hawelka, à Mahony et à un nombre considérable de commentateurs – je lisais par exemple ceux qui ont précédé Mahony, Shentoub et tous les gens qui ont publié dans l’International Journal of Psychoanalysis dans les années 50 sur ce cas et ont retrouvé toutes sortes de choses – que parce que leurs analyses trahissent là une certaine conception de l’Œdipe, qui est censée être mise en difficulté de manière paroxystique dans la névrose obsessionnelle.
Cette conception de l’Œdipe du garçon et de son organisation dans la névrose repose sur une question problématique : comment, si le père est celui qui interdit de jouir de la mère, si c’est un pur rival, un interdicteur et un rival, alors comment peut-on s’identifier à lui ?
Essayez de résoudre cela sans distinguer le symbolique et l’imaginaire, ni sans produire des explications qui se réfugient sur la notion de conflit en se disant qu’au coup par coup, on verra bien qui gagne...
Vous m’en direz des nouvelles.
La seule solution disponible est de s’appuyer sur la métapsychologie de la bisexualité psychique, et de dire qu’il y a un lien homosexuel radical et primaire qui fait que le garçon se fait par amour l’objet du père. Et cette homosexualité originaire consiste pour le garçon à être fondamentalement féminisé et passivé dans son lien au père. Il ne saurait donc y avoir de solution identificatrice que par ce moment homosexuel dans le rapport au père interdicteur et au rival. C’est sur cette base-là que se déploie l’argumentation contre Freud, selon laquelle Freud n’a pas vu qu’il incarnait ce père interdicteur violent et violeur – puisqu’il baise le fils, dans le fantasme -, et non plus qu’il offrait par ce biais-là l’espoir d’une introjection pacifiante, puisque le point dans lequel les choses se renversent et où on a accès à l’idéal, c’est qu’une fois le pénis paternel introjecté analement, cette introjection anale permet cette identification virile qui rapporte le fils à son père comme à un idéal. Je crois que cette conception de l’Œdipe qui est obligée d’en passer par un moment homosexuel d’introjection anal du pénis paternel, pour résoudre le paradoxe de l’identification au père alors que le père est un père interdicteur et un rival, nous ouvre tout un monde clinique, et explique très bien ce qu’est le traitement orthodoxe de la névrose obsessionnelle. Le traitement orthodoxe, je dirais annafreudien de la névrose obsessionnelle, mais qu’on trouve également chez Maurice Bouvet par exemple, dans l’école française, consiste à pousser l’obsessionnel à associer sur son homosexualité, sur ses traits d’homosexualité, et à interpréter justement son analité dans le sens de la grande difficulté à introjecter le pénis creux anal, au sens où la liaison associative va permettre à partir de ces fantasmes anaux – qui chez Bouvet prennent parfois des proportions un peu impressionnantes, quand même ! -, que ces fantasmes anaux, prenant cette structure dans l’association et le transfert, construisent une introjection là où il y avait une incapacité à symboliser.
Ça, c’est effectivement quelque chose qui n’est pas absurde, et qui est même largement attesté en clinique, qui est l’idée que l’association sur les traits d’homosexualité dans la névrose obsessionnelle est effectivement thérapeutique. Je ne sais pas si on peut dire que c’est ce qui est thérapeutique, mais si vous discutez avec des analystes un peu expérimentés, ils vont diront que ça fait du bien aux gens d’être capable de sortir de cette espèce de cuirasse agressive en accommodant leur position masculine d’une certaine dose de tendresse, de passivité et de féminité.
Le problème que ça pose aussi, c’est un problème que j’ai soulevé il y a quelques séances, est un problème éthique. Qu’est-ce que c’est que l’assomption de l’identité sexuelle si vous avez cette conception de l’Œdipe ? Cette assomption de l’identité sexuelle est fondamentalement dépendante d’un idéal, ce qui induit un effet de norme immédiat. Quand on aborde les choses de cette manière-là, devenir un homme, c’est devenir un père ! Et je vous avais pointé les remarques de Mahony sur l’échec du traitement de Freud, selon lesquelles l’échec viendrait du fait qu’il aurait permis à Lanzer d’épouser une femme stérile, moyennant quoi il aurait reconduit en le laissant faire ce choix d’objet d’une femme stérile, son incapacité à devenir père. Tout cela est extrêmement cohérent. Si l’identification paternelle passe par cet idéal, par le temps homosexuel puis un rapport idéal où la normativation sexuelle se fait par une identification virile à un homme qui est en même temps un père et qui ne peut être un homme que parce qu’il est un père, alors la fin de l’analyse, le sens dans lequel l’analyse est orientée, c’est bien sûr de faire des pères, et non pas de faire des hommes. Et donc, on aboutit par ce biais, qui est un temps complètement imaginaire, qui est la passivation homosexuelle du patient, à recouvrir pour de bon l’opposition masculin / féminin à l’opposition actif / passif. Le type de liberté imaginaire que l’on construit, et qui a incontestablement, je ne le nie pas, un effet thérapeutique dans cette prise en charge de l’obsédé, ça consiste à dire qu’être un homme c’est être actif, et être une femme c’est être passif.
Ce qui rend par exemple énigmatique ce que pourrait être une activité féminine ou une passivité virile. Si une analyse débouchait sur une forme de capacité pour un homme d’être passif, par exemple d’être capable d’avoir des rapports homosexuels, si ça permettait à une femme d’avoir quelque chose qui serait une activité qui lui serait propre, on pourrait trouver dans cette conception des choses que c’est un échec de l’analyse. Car on fait jouer au registre de la passivation homosexuelle un caractère normatif par rapport à une seconde norme, qui est l’identification de l’homme au père. Vous avez un double système d’identification comme ça, on passe par ce moment de passivation indispensable, c’est la seule manière dont on peut se représenter, à travers la bisexualité psychique, l’introjection du pénis anal, et l’introjection du pénis anal n’est pas l’introjection du pénis d’un homme, mais du pénis d’un père, moyennant quoi on réussit l’identification paternelle.
Je me demande dans quelle mesure cette conception de l’Œdipe n’est tout simplement pas un fantasme obsessionnel ! Qu’est-ce que c’est d’autre qu’un fantasme obsessionnel ? Avec le problème que ça pose, qui est de savoir si on peut expliquer le fantasme obsessionnel avec des termes théoriques qui sont le même fantasme obsessionnel, mais abstrait ! Parce que quelle est l’idée qu’on a ici du père ? C’est précisément l’idée obsessionnelle du rival interdicteur de la jouissance de la mère, autrement dit, de quelqu’un qui est virtuellement castrateur, mais castrateur pour de bon ! Il est « virtuellement castrateur pour de bon », si j’ose dire… Effectivement, comment introjecter un père pareil ? Est-ce que vous entendez combien la question est obsessionnelle ? Parce qu’introjecter, ça suppose une chose, ça suppose qu’on aime. On n’introjecte que ce qu’on aime. Une fois qu’on l’a introjecté, on peut le haïr, mais le principe même de l’introjection c’est qu’on ne se met à l’intérieur du psychisme que ce qui est aimé. C’est même absolument équivalent, aimer et introjecter, à cet égard. Voyez pourquoi Freud est embarrassé, en différents endroits. C’est pourquoi d’ailleurs le surmoi n’est pas le premier concept qui apparaît chez Freud, mais que c’est l’idéal du moi : avant qu’il y ait un surmoi, avant qu’on puisse introjecter une figure qui est ambivalente et dans laquelle l’amour et la haine sont inextricablement mélangés, il faut supposer un idéal du moi. Le côté de l’idéal du moi, c’est le côté de l’introjection, le côté de l’introjection primaire. Le surmoi est quelque chose qui vient dans un second temps. C’est dans la théorie de Freud à partir de l’idéal du moi qu’est construite la notion de surmoi.
Or, vous comprenez ici pourquoi Freud ici est en quelque sorte théoriquement et automatiquement acculé à aller chercher chez Lanzer un refoulement de la haine. Il est obligé d’aller chercher un refoulement de la haine, puisqu’il lui faut supposer que cette espèce de mise à l’intérieur et de symbolisation du père a d’abord exigé de l’amour. Et voyez pourquoi l’amour et la haine vont être mis au centre de la problématique de la névrose obsessionnelle : ce n’est pas tellement parce que ce serait ce que le patient nous raconte, mais c’est parce que la difficulté du patient avec le père ne peut être comprise qu’à travers cette difficulté de la construction de l’Œdipe à ce moment-là, chez Freud. Or, cette conception, on peut se poser la question de savoir si ce n’est pas un fantasme obsessionnel épuré, et non pas quelque chose qui sert à expliquer le fantasme homosexuel. Et vous voyez pourquoi l’insistance des commentateurs est grande à faire dire à Freud et à Lanzer ce que ni l’un ni l’autre ne disent si fortement – ils le disent, Freud repère très bien qu’il y a une question d’homosexualité qui est en cause, mais ce n’est pas parce qu’il y a une question d’homosexualité qui est en cause, que c’est ce à quoi on doit recourir méthodiquement pour tout expliquer à l’intérieur du cas.
Voyez a contrario les conséquences importantes de la divergence de position de Lacan, sur la question du père, qui sont des divergences qui n’ont pas du tout pour simple conséquence que de décrire autrement ce qui se passe dans la névrose obsessionnelle, c’est aussi de traiter autrement l’association. Si la question qu’on se pose est un peu différente, si la question devient : qu’est-ce qui peut mettre en ordre les contradictions du désir, devant cette espèce de folie de pensée qui cherche à rendre compatible des trucs complètement incompatibles ? et qu’est-ce qui peut faire – c’est un but thérapeutique je crois complètement honorable -, qu’un obsessionnel ne s’en remette pas au hasard pour trancher, c’est-à-dire qu’on puisse épargner un peu plus ces moments de démission si sensibles subjectivement dans lesquels un patient va comme ça faire n’importe quoi en fonction de l’opportunité qui se présente, et après avoir résister des mois ou des années à je ne sais quelle sollicitation, va tout d’un coup, Dieu sait pourquoi, se mettre à accepter quelque chose qui est fondamentalement inacceptable et contraire à son désir? L’idée lacanienne d’une identification paternelle symbolique pointe quelque chose qui est exactement opposé à la conception annafreudienne du père : c’est que bien loin d’être un interdicteur du désir, le père montre l’exemple que le désir est possible. C’est ça je crois la différence absolument radicale qu’il y a entre le père annafreudien et le père lacanien. C’est que le père désire, que la faute du père est réelle, mais cependant, elle n’est pas intolérable : le père ne meurt pas d’être en faute dans son désir.
Car que sont, et c’est un trait clinique important, les plus graves névroses obsessionnelles ?
Ce sont les cas où le désir du père est égal à zéro ! Alors, là, quand le père est cette espèce de vieille chose croulante qui ne bande jamais, c’est un ravage, pour une raison très simple : c’est que tout est interdit parce qu’il n’y a rien qui désire, il n’y a rien qui ouvre la possibilité de… Ou à l’autre extrême, un autre type particulier mais extrêmement ravageur de père, c’est les pères avec cet aspect paranoïaque, avec cette espèce de nuance de folie, de violence, de cruauté dans l’exercice de leur paternité, où là, ce n’est pas que le désir du père est égal à zéro, encore que ça y revienne, c’est qu’il n’y a que jouissance. A ce moment-là, là non plus il n’y a pas de désir permis. On ne se pose pas assez la question je crois de savoir si le père n’a pas trop interdit. N’ait pas interdit quoi, qu’il n’ait d’abord permis ? C’est un point essentiel qu’il faut vraiment méditer, quand on a cette question d’avoir à évaluer la fonction qui est donnée dans des associations à des descriptions de parents : le père n’interdit que ce qu’il s’est permis, et de ce qui est donc permis en un certain sens, justement le sens symbolique ! Ce qui se passe avec ces regards sous les jupes des bonnes, dont je suis parti pour parler de la sexualité infantile, c’est ça les regards sous les jupes des bonnes : c’est qu’on se permet. Ça ne peut être interdit, que parce qu’il y en a qui se le permettent. Donc le père n’interdit pas de désirer la mère et toute femme, il montre que c’est permis et la preuve, il le fait, et par là, la rivalité imaginaire est tempérée par l’identification symbolique. Non seulement cette identification symbolique tempère la rivalité imaginaire, sur l’axe justement qui est problématique chez les freudiens orthodoxes qui essaient de le penser à travers l’introjection du pénis anal, mais en plus elle fait apparaître une autre dimension : encore faut-il que du père réel, il y est ! C’est-à-dire qu’il faut qu’il y ait quelqu’un qui de ce désir fasse acte, sans que ce soit nécessairement pure jouissance, et c’est quand même un cas très classique d’un père qu’on confond avec un père interdicteur et qui n’est rien d’autre qu’une brute violente dont le moindre caprice est une loi, et qui est père au sens également que ce ne soit pas un père dont le seul désir soit de ne pas désirer.
C’est peut-être je crois le type de névrose obsessionnelle qu’on a trouvé plus tard dans le mouvement analytique, certains cas que raconte Abraham, aux limites de la mélancolisation. Car quand rien n’est permis, ça produit des sujets obsessionnels – j’ai parlé longuement de l’un d’entre eux il y a quelques années – pour lesquels tout est interdit parce que rien n’a été permis. D’ailleurs, les modalités narcissiques de ce type d’obsessionnel sont tout à fait différentes de celles de l’homme aux rats.
La conséquence de ceci – je vous dirais à la fin de mon séminaire ce que seraient à mon avis les bonnes voies où engager les cures de névrosés obsessionnels, mais je peux au moins vous donner trois petites indications sur la différence pratique que fait la conception de Lacan. C’est que le but de la cure n’est certainement pas l’assomption d’une forme d’homosexualité, ou de la bisexualité psychique. Ça ne veut pas dire, bien évidemment, qu’il n’y ait pas, dans la cure, une épreuve particulière qui est de surmonter le fantasme d’être baisé par le père, qui est certainement comme le point de fixation symptomatique le plus difficile de toute analyse de névrosé. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire qu’on n’est pas obligé à cet égard de se servir de manière normativante de ce moment imaginaire du fantasme d’être l’objet d’amour sexuel du père. On n’est pas obligé d’y introduire là des éléments de normativation. La deuxième chose, c’est que si vous parlez de père symbolique, et que ce n’est pas un idéal qui implique qu’on est homme parce qu’on est père dans le processus que je vous ai décrit tout à l’heure. On a besoin d’un niveau de définition du père symbolique qui est structural. Vous ne le trouvez – et c’est ça qui rend les choses assez frappantes chez Lacan – que dans un système social où les parents, la différence des sexes et des générations, n’est à sa place que parce que c’est un ordre propre, qui ne doit rien au travail de l’idéalisation de chacun des individus de la société, mais qui fixe ces places, et ces places en tant que place de père, place de mère, etc. Et donc la différence des sexes n’est justement pas construite ou assimilée aux identités sexuelles par l’appui qu’on prend sur un idéal, mais par la position d’un père symbolique dans une structure qui elle-même est symbolique, une structure de parenté. Et la troisième chose, qui est très importante je crois dans le suivi de l’association, c’est que là où l’obsessionnel est tout le temps en quête du référent ultime, du vrai sur le vrai dans une quête ravagée par le doute, par le « est-ce que c’est bien ça, est-ce que j’ai bien dit ça ? », où l’association devient en quelque sorte le lieu même d’un rituel de vérification, l’accent peut-être mis sur quoi ? L’accent peut être mis sur les surprises du signifiant, c’est-à-dire sur l’idée que ça tient tout aussi bien si on n’a pas de point fixe. L’idée de se servir de surprises - non pas du tout parce qu’il s’agit de faire marrer les patients, parce que ce n’est pas le fait qu’on les fasse rigoler qui va les guérir -, le fait de faire jouer les éléments de Witz, et de montrer que l’ordre n’a pas besoin d’être soutenu par un référent imaginaire qui viendrait là quelque part enfin tout mettre en ordre, par ce dispositif qui est un usage de l’humour qui n’est pas thérapeutique parce que ça fait rigoler, mais parce que ça montre que l’ordre n’est pas celui qui est imaginairement construit par la quête d’un référent, mais que quelquefois il peut être totalement perturbé et que pourtant, qu’on retombe juste néanmoins par rapport au désir. Ce type d’intervention est très spécifiquement une intervention que faisait Lacan avec les névrosés obsessionnels, qui consiste à mettre l’accent sur le dispositif énonciatif et sur le fait qu’il y a un élément arbitraire dans le signifiant qui n’empêche pas l’ensemble du dispositif de tenir. Parce qu’on sait bien à quoi tend l’obsessionnel. C’est que dans sa quête du référent ultime, il fait comme l’homme aux rats : c’est que soit finalement il s’en remet à Dieu, soit il s’en remet au hasard, soit il s’en remet aux deux parce que c’est finalement la même chose, pourvu que ce ne soit pas lui.
Quoi qu’il en soit, et je conclu ma parenthèse comme ça, ce n’est pas l’homosexualité d’Ernst Lanzer qui fixe dans le transfert, c’est la promesse d’un ordre dans le désir et dans ses contradictions, et d’un ordre justement médié par des lapsus et par les jeux de mots qu’il a repérés dans la Psychopathologie de la vie quotidienne, et qu’il suppose au travail chez Freud. Et ce que je vous dis là me paraît infiniment plus congruent avec l’ordre dans lequel il fait les choses, que la question métathéorique et obscure de savoir ce qu’est l’homosexualité de l’homme aux rats.
*
La quatrième séance commence par un récit dont Freud nous a heureusement dispensé des méandres à mon avis absolument infinis dans lequel l’homme aux rats l’a entraîné pour lui raconter la mort de son père. Je vous signale parce que j’aime ce roman et parce que c’est exactement le genre de situation qui ne peut que frapper, lisez le récit de la mort du père dans La conscience de Zénon par Italo Svevo, qui est à mon avis le plus beau roman de la névrose obsessionnelle, le plus drôle aussi, et vous verrez à quoi peut ressembler la mort d’un père construit dans le magnifique dispositif qu’a inventé Svevo. Ce scénario de la mort du père, si vous vous refusez aux facilités psychologiques – au « ah, comme c’est triste ! » - qu’est-ce qui peut faire que chez l’homme aux rats, ça va devenir un deuil pathologique ? S’il fallait dans ces moments de circonstance, être impavide, à tenir la main du père, à être là jusqu’au bout, à ne pas avoir la moindre espèce de mauvaise pensée pendant qu’on perd son père, mais nous serions tous des hommes aux rats ! Nous serions tous des hommes aux rats, et donc la description de cette scène si pathétique soit elle, n’explique absolument pas pourquoi ça fait cet effet à l’homme aux rats. Je dirai même que la conscience de Zénon et l’admirable description de la mort du père nous fait bien voir que des histoires comme ça, on en a des tas, et que nous sommes remarquablement équipés pour y résister, à nos fautes, dans les grands moments de deuil. Pourquoi est-ce que chez lui ça va déclencher une pathologie aussi redoutable ?
Un deuil pathologique, dans la névrose obsessionnelle, nous dit Freud, c’est quelque chose qui tient le moyen terme entre le deuil simple et la mélancolie, et c’est spécifique dans la névrose obsessionnelle. Ça tient le moyen terme de la façon suivante : c’est qu’un deuil normal, c’est la perte de l’objet. Un deuil pathologique dans la névrose obsessionnelle, c’est la perte de l’objet plus l’ambivalence. Et le deuil pathologique dans la mélancolie, c’est la perte de l’objet, l’ambivalence et l’identification à l’objet. Ça ne veut pas dire qu’il y a un continuum, et qu’à partir du moment où vous avez de l’ambivalence, vous allez vous identifier à l’objet ! Absolument pas. Mais ça montre comment certaines formes extrêmes de névrose obsessionnelle, dans les moments de deuil chez les grands obsédés, peuvent évoquer les tableaux mélancoliques, moins une chose qui est quand même extrêmement importante et que je vous souligne, moins l’identification à l’objet, c’est-à-dire moins cet exhibitionnisme dans la plainte et l’auto-accusation. C’est-à-dire qu’il n’y aura pas cette dimension particulière de festin horrible, qu’il y a dans la mélancolie, puisque tout restera toujours sous le signe de la honte d’y prendre tant de plaisir. C’est toujours un élément qui néanmoins peut être susceptible si vous voyez ces choses à l’hôpital d’un traitement pharmacologique, parce qu’on atteint là des points d’effondrement dépressif majeur. C’est là où devant l’angoisse du patient - il a de plus en plus eu l’impression que dans l’au-delà il survivait et qu’il ne le perdait absolument pas, et là les symptômes ont commencé à devenir extrêmement inquiétants puisqu’il était capable comme un fantôme de l’évoquer - sa faute à l’égard du père a commencé à le dévorer, cette faute qui consistait à ne pas s’être rendu le jour où il fallait qu’il se rend à… Je vous le lis ?
« Je me suis résolu ………….…. quelque chose de criminel envers lui » (Freud, OC IX, pp.151-3).
Et alors ça revient d’une façon catastrophique au moment du deuil d’une tante par alliance, et c’est à partir de ce moment-là qu’il ajouta à son édifice de pensée la suite dans l’au-delà, avec une très grande incapacité, une inhibition au travail gigantesque. Et là, Freud dit ceci : « Comme il raconte que seules l’avait alors soutenu les consolations de son ami, qui repoussait toujours ses reproches comme fortement exagérés, je profite de cette circonstance pour lui donner le premier aperçu des présuppositions de la thérapie psychanalytique. S’il y a une mésalliance entre le contenu de représentation et l’affect, etc… », et il lui sert sa petite soupe. Petite note : « La description (avant qu’il ne lui fasse un cours de théorie sur ce qu’il convient de penser psychanalytiquement) plus précise de cette circonstance permettra plus tard de comprendre cet effet (plus tard, malheureusement). L’oncle devenu veuf s’était écrié en gémissant : « d’autres hommes s’autorisent tout ce qui est possible, et moi je n’ai vécu que pour cette femme ! ». Notre patient supposa que l’oncle faisait allusion à son père, et en suspectait les fidélités conjugales. Et bien que l’oncle contesta cette interprétation de ses paroles de plus en plus résolues, leur effet ne pût plus jamais être supprimé ». Là, il rassure le patient, comme Galatzer, au point exact où le patient se fait couper la parole, et se fait couper la parole sur quoi ?
C’est je crois qu’il faut avoir ici égard à l’indicible, au lieu de supposer que le patient a besoin d’être rassuré. Quelle est la place de l’indicible ? La place de l’indicible, c’est cette chose horrible que le père a pensé, parce qu’on le lui (Ernst) a fait penser, qu’il aurait pu être infidèle à sa femme. Alors je crois que cet insupportable qui est indicible, dans la séance, qui est la mise en cause du père par autrui, n’a vraiment rien à voir avec ce que Freud va lui proposer, de manière thérapeutique, qui est une espèce de schéma mécanique de ce qui se passe entre les représentations, et qui fait qu’il serait empêché.
Je veux à cet égard faire une remarque, parce que j’ai publié cette petite histoire dans un de mes essais, cette histoire qui m’avait énormément frappé d’un jeune homme très malade, très obsessionnel, avec des symptômes extrêmement graves, qui était venu me voir, que j’avais accueilli sans faire aucune espèce de commentaire, qui me racontait toute une symptomatologie proliférante, extrêmement douloureuse, avec des obsessions gravissimes, des choses qui étaient encore plus folles que dans l’homme aux rats, et qui à un moment – pour vous donner une idée de la fragilité extraordinaire de ces choses-là –, il ne parlait absolument pas de son père, mais que de sa mère et de la façon dont il avait été éduqué, et dit qu’une des choses terribles qui avait frappé son adolescence, c’est qu’un jour le jeune garçon avec qui il avait passé toute son adolescence – ils avaient quatorze ans -, lui dit cette simple phrase : « Mais comment est-ce que ton père peut être avec ta mère ? ». Tout ceci suivait un flot de descriptions absolument catastrophiques sur la façon dont cet enfant et cet adolescent avait été élevé et avait vécu le rapport à sa mère. Et là, il me regarde et 20 ans après il avait la même expression horrifiée devant ce que dans cette phrase, il y avait quelque chose d’absolument inimaginable, d’indicible. Je crois bon à ce moment-là - en plus ça tombait à peu près bien dans mes heures -, d’arrêter. Eh bien, il a suffi que j’arrête là, pour qu’il ne revienne jamais. C’est-à-dire, le simple fait d’avoir pu être supposé que j’étais du côté de l’autre capable de mettre en cause le père, a suffi à interrompre avec la plus définitive violence toute amorce de transfert. On ne se rend pas compte des coordonnées de l’indicible dans ces histoires de névrose obsessionnelle, on ne se rend pas compte qu’une question comme ça – peut-être mon silence faisait-il résonner l’obscénité potentielle du « qu’est-ce que ton père fait avec ta mère » -, et le fait d’avoir travaillé dans la coupure n’a fait que valider le caractère horrible de ce qui était ici indicible.
Je crois que ce qui se passe à ce moment-là, quand c’est des séances et des séances après, que Freud va apprendre pourquoi ça s’est passé à l’enterrement de la tante par alliance, ça me paraît poser un problème très fin de timing de l’attention à ce qui peut être dit et ce qui ne peut pas être dit. Ce sont des choses qu’on peut apprendre des années après, dans une analyse, que le moment où on a cru être bien malin, on a coupé quelque chose qui était au bord de se dire.
Je vais rentrer dans ce que Freud nous propose ici. Je vous ai dit la dernière fois à quel point j’étais sceptique sur la pertinence du modèle de la séparation représentation-affect, parce que je trouvais que c’était concevoir l’obsession sur le mode de la phobie, en faisant comme si il pouvait y avoir n’importe quelle représentation attachée à l’affect d’angoisse – vous vous rappelez du travail que j’avais fait sur folie et obsession -, et d’une certaine manière, même si dans l’obsession il y a plus d’affect que l’angoisse – il y a l’auto-reproche qui est considéré comme un affect par Freud – il y a néanmoins aussi un nombre de représentation par contiguïté extrêmement important, peut-être un peu moins vaste que les représentations des objets phobiques, mais quand même extrêmement vaste.
Pourquoi est-ce que cette opposition représentation–affect est-elle massive ? Parce qu’elle détruit l’unité de ce que je cherche à capter lorsque je vous parle de grammaire logique de l’affect. Ce qu’elle détruit, c’est précisément cette intentionnalité du désir, cette intentionnalité conative comme on dit, qui est l’attitude du sujet envers le monde, attitude que la réalité ne commande pas, comme dans la croyance, mais qui est l’attitude d’orientation même. Or, il va de soi que l’affect et le désir, c’est à ce niveau-là, à ce niveau de l’attitude subjective que les choses se décident. Or, ce qu’il y a de très intéressant dans cette séance, c’est que le patient va tout à fait sauter sur cette opposition. En posant des questions tout à fait pertinentes, il va dire : « mais alors en fait, c’est comme l’opposition entre ma bonne personnalité et ma mauvaise personnalité, entre le mal et le bien », et Freud, bien qu’il dise que ce n’est pas tout à fait ça et que c’est trop grossier, va abonder dans son sens, en disant : « il suffit de remplacer la bonne partie de vous-même par votre moi, la mauvaise par votre inconscient infantile, et vous avez à peu près compris de quoi il s’agit ». Tout ça, toujours avec pour but de rassurer le patient. Mais pas si facilement, parce que Ernst Lanzer qui a l’esprit critique, se demande bien, si l’affect et la représentation peuvent être détachables à ce point, pourquoi quand on les recolle, ça devrait faire partir l’affect ? C’est une excellente question ! Et pourquoi est-ce qu’on en guérit ?
Et alors, Freud lui dit : « C’est dans la nature des choses… ».
Ce n’est pas rien ! C’est une réponse qui atteste la fragilité théorique du montage. Ernst Lanzer lui fait remarquer que ça doit faire guérir certains mais pas les autres, et si ça ne guérit pas avec lui, alors ? Ça met par ailleurs Freud dans la position de celui qui promet la guérison : « c’est dans la nature des choses », lui dit-il ! Est-ce qu’on peut donner une meilleure réponse ?
On peut essayer de donner une meilleure réponse, mais en bougeant un peu par rapport à nos représentations les plus communes de la façon dont fonctionne la théorie analytique. Est-ce que l’on peut traiter l’affect comme définitivement extra-verbal, extra-représentationnel ? Même chez Lacan, le désir n’est pas le signifiant : il est tramé dans le signifiant, il est le sens, qui dit désir dit sens, ce n’est pas le signifiant lui-même. Il parle d’effet de sens, comme manifestation des effets du désir, mais il maintient en fait fondamentalement à travers la notion du signifiant, l’extériorité de la représentation par rapport à l’affect.
On m’a ainsi fait une remarque, par rapport à ce que j’ai fait la dernière fois, à propos de mes travaux sur le fait que les verbes de désir étaient suivis de complétives au subjonctif, tandis que les verbes de croyance étaient suivis de complétives à l’indicatif. On m’a fait une remarque qui est très juste, qui est qu’en réalité, le subjonctif dont je parle, le subjonctif français, est un subjonctif de grammaire scolaire, mais d’un point de vue linguistique, ce que nous appelons dans la grammaire du français le « subjonctif » a des fonctions linguistiques extrêmement diverses. Je voudrais à cet égard revenir sur l’analyse classique qui remonte à Laplanche mais qui a aussi été faite par d’autres, sur la texture linguistique de ces fameuses phrases du type : « ne pas restituer l’argent », « mon père mourir », « que mon père meure », qui sont les moments pivots de la constitution des obsessions. On dit régulièrement, je regardais encore ça dans Laplanche cet après-midi, qu’en fait, lorsque nous employons ces infinitifs à l’état pur, « prendre le train à 14 heures » par exemple, ça veut dire : « il faut prendre le train à 14 heures ». On peut substituer effectivement à « mon père, mourir », « que mon père meure », et une fois qu’on a dit par exemple « que mon père meure est une chose abominable », le simple fait de dire « que mon père meure » s’entend déjà comme quelque chose de l’ordre du souhait. Et dans la 5ème séance, Freud va faire remarquer que « je ne veux pas penser que mon père meurt/e » est une manière non seulement de penser que mon père va mourir, mais c’est même déjà d’une certaine manière, le souhaiter.
Ça pose toutes sortes de difficultés, que je pourrais préciser en travaillant de manière comparative, parce qu’évidemment, ces histoires ne peuvent pas se pratiquer dans une seule langue.
Les linguistes distinguent avec les verbes quatre choses. Ça va être un peu technique, mais je voudrais que ce soit clair dans vos esprits.
Ils distinguent la diathèse (le passif, l’actif, le moyen, le réfléchi), qui sont la façon dont un sujet est engagé dans le procès du verbe, ils distinguent le temps (passé, présent, futur), ils distinguent l’aspect, c’est-à-dire les propriétés temporelles du processus verbal lui-même (est-ce qu’il est continu, est-ce qu’il est en train de se faire, est-ce qu’il a atteint un point terminal ? Par exemple le parfait ou l’imparfait sont des déterminations de l’aspect), et le mode, dont vous connaissez au moins l’indicatif, et il y a aussi l’interrogatif, l’impératif, le subjonctif, mais il y en a beaucoup d’autres. Un mode, c’est ce qui permet de spécifier le lien intentionnel, l’attitude du sujet par rapport à la réalité. Ce n’est pas exactement comme la diathèse qui situe le sujet par rapport au processus du verbe, mais c’est quelque chose qui articule l’attitude du sujet par rapport à la réalité dans le processus verbal. Par exemple, l’infinitif qu’on trouve dans « ne pas rester l’argent », n’existe pas dans toutes les langues. Il y a des langues sans infinitif, par exemple le grec moderne n’a pas d’infinitif, ce qui pose d’ailleurs la question de savoir si l’infinitif est un mode. En hébreu, qui est une langue qui n’est certainement pas totalement indifférente aux protagonistes de L’homme aux rats, il y a une forme d’infinitif très particulier qui est ce qu’on appelle l’infinitif absolu. L’infinitif absolu est un infinitif qui renforce absolument le verbe. Ce n’est pas « tu vas mourir », mais quand on l’utilise sous la forme de l’infinitif absolu, c’est « oui, tu vas mourir ! Tu vas mourir, c’est sûr ! Absolument, tu vas mourir !», quelque chose comme ça, qui est une forme tout à fait spéciale qu’il ne faut pas perdre de vue, parce que ça montre bien que dans les modes, se manifeste en fait non seulement la présence d’un sujet abstrait de l’énonciation, mais d’un sujet de l’énonciation qui peut toujours éventuellement être engagé dans des intérêts, qui sont des intérêts affectifs.
Je vous signale d’ailleurs qu’en anglais, le mode, c’est « mood », c’est-à-dire l’humeur, la façon d’être affecté. C’est pour ça d’ailleurs que c’est même tellement des manières d’être affecté que l’indicatif a un statut particulier. Ce qu’on appelle l’indicatif, c’est le mode sans mode, le mode par défaut, le constat factuel, c’est quand on n’a pas encore dit d’une certaine manière, comment le sujet y était impliqué. On ne trouve l’indicatif dans une langue que lorsqu’on a réussi à montrer qu’il n’y a aucune autre construction modale, aucun autre « mood » au sens de l’anglais, qui est impliqué dedans. Autrement dit, si l’indicatif est le mode par défaut, tous les autres mettent en défaut le mode indicatif, d’une certaine manière ils le « modalisent ».
Si on essaie de caractériser les langues dans lesquelles il y a bien des distinctions entre le subjonctif, l’optatif, etc., à quoi arrive-t-on ? On arrive à l’idée que le subjonctif renvoie à ce qui est utilisé spécifiquement pour ce qui est incertain dans les faits. Et d’ailleurs en japonais, il y a un mode particulier, on l’appelle le tentatif qui est un mode pour dire que ce dont on parle n’est pas certain, n’est pas un fait avéré, ce qu’on est obligé de traduire par le subjonctif semble-t-il. C’est un mode particulier, parce qu’il se contente simplement de suspendre, dans l’énonciation, les affirmations de certitude qui sont déjà présentes dans l’indicatif. Dans l’indicatif, il y a le fait. Une modalisation du fait, c’est d’enlever au fait, le fait qu’on dise qu’un fait est un fait. Et le tentatif est intraduisible dans plein de langues, parce que soit on est obligé de traduire par un présent en ajoutant des adverbes – peut-être, éventuellement, il se trouverait que, etc. – soit on est obligé d’utiliser des modalités comme le subjonctif. Il y a un mode en turc, par exemple, qui s’appelle le dubitatif, qui est un peu plus que le tentatif du japonais. Le dubitatif ajoute une dimension d’hésitation du sujet. Ce n’est pas soustraire à l’indicatif tout ce qu’il pourrait y avoir de trop indicatif dans l’indicatif, c’est ajouter au simple suspens du fait, quelque chose comme une affirmation que le fait est suspendu. Tout ceci correspond à des désinences particulières, il y a des indicateurs morphologiques de la présence du verbe. L’optatif, ce serait le mode sous lequel dans la plupart des phrases que je vous ai données de désirer + complétif avec subjonctif, en grec ancien par exemple, on utiliserait l’optatif pour marquer le choix. L’optatif a des particularités étranges. J’ai découvert par exemple que dans le finnois, à l’oral, l’optatif ne sert pas à dire « puisse X faire p », mais « qu’il fasse p, et qu’il aille se faire voir ! ». C’est extrêmement curieux ! C’est-à-dire que vous utilisez l’optatif pour manifester un désir accompagné de votre sentiment d’impuissance à ce que ce désir se réalise du fait de ce que l’autre pourrait faire. « Je le désire, et puis voilà, je le veux, et puis so be it » (« fais-ce que tu veux », locution anglaise adverbiale qui sert à traduire l’optatif finnois, d’après ce que j’ai appris, mon savoir est tout récent). En tout cas, c’est un usage intéressant, parce qu’en grec ancien – j’ai vérifié dans une grammaire -, il n’y a pas d’usage de l’optatif comme ça. A nouveau, vous voyez combien ces modes servent à énoncer des positions subjectives qui sont extrêmement loin d’être abstraites, et qui sont des nuances dont nous avons l’impression qu’elles ne relèvent pas de la grammaire mais de la rhétorique, alors qu’en réalité, ce sont des formes syntaxiques qui sont asservies à des fonctions qui ne sont pas si rhétoriques que ça, mais qui indiquent en quelque sorte les dispositifs sous-jacents. Il y a même un mode, et c’est une chose extrêmement frappante et complexe, négatif. Le mode négatif nous est peu familier dans la mesure où pour nous, le négatif consiste simplement à ajouter des particules dans l’indicatif. Mais il y a des langues, et l’anglais moderne semble bien être une langue comme ça, où lorsque par exemple vous avez des négatifs archaïsants – thou remembrest not , « tu ne t’es pas rappelé », qu’on trouve dans Shakespeare – vous avez « you did not remember ». Or, si vous faites bien attention, il vous faut un helper – le verbe to do, le verbe faire – soit un auxiliaire au prétérit + la particule. Ce qui montre que vous avez une autonomie syntaxique de la négation, qui construit la négation non pas simplement comme l’adjonction d’une particule, mais comme un véritable mode. Je crois que c’est très important, parce que dans toutes les tentatives de traiter la négation comme un opérateur logique qui viendrait s’insinuer dans des phrases à l’indicatif, on oublie que nier est une attitude subjective à l’égard des choses, et non le constat à l’indicatif de l’absence de quelque chose dans le monde. Ça a toute sorte de conséquence quand on y réfléchit.
Il y a des choses extrêmement exotiques, dasn ce genre. J’ai appris comme ça l’existence du cohortatif, qui n’est pas l’impératif. L’impératif est souvent un cohortatif, mais le cohortatif, c’est lorsque vous avez une forme morphologique et une syntaxe particulière pour « allons-y ! ». C’est la différence qu’il y a en français entre « allons ! » et « allons-y ! ». « Allons-y », c’est du cohortatif parce que c’est une manière de s’encourager à faire les choses. La nuance entre « Go ! » et « Let us go », c’est que « go » c’est « allons » ou « allez » en anglais, et « Let us go ! » c’est plutôt « Courage, allons-y ! ». Et vous avez donc comme avec do un auxiliaire let et une construction syntaxique particulière.
Pourquoi est-ce que je vous fais remarquer toutes ces choses-là ?
C’est qu’il y a une grammaire. S’il y a une grammaire des affects, c’est-à-dire s’il y a une intention aux affects, aux moods, c’est que vous voyez que ces différentes attitudes qui sont l’espace véritable, de ce qu’on devrait appeler le désir, de ce à quoi nous avons affaire, c’est-à-dire du point de vue du sujet par rapport à la réalité, l’orientation intentionnelle qu’il donne à ce rapport-là – le nier, l’interroger, donner des ordres, etc. – dans lequel se manifeste sa présence subjective, est en réalité déjà complètement inscrit dans un espace de différences signifiantes marquées dans la langue, qui est entièrement dans son dire.
Et donc, un des traits particulier dans cet espace, c’est que l’intentionnalité y est absolument identique à la réalisation de cette intentionnalité. C’est la grande différence qu’il y a avec la croyance, où on ne peut pas croire quelque chose de faux. Croire, c’est croire quelque chose de supposé vrai, et ça dépend de l’état du monde. C’est ce que je vous avais distingué comme les deux directions – directions of fit – qu’on a : du monde au sujet et du sujet au monde. La croyance est entièrement ordonnée en fonction de l’état du monde, tandis que tous les autres modes sont en fait ordonnés en fonction de l’état du sujet.
Mais ce que je veux dire par là, c’est que ce que nous appelons la « réalité psychique », lorsque nous traitons comme une chose ce qui se trouve du côté du sujet modal, du sujet des moods, en quelque sorte, cette réalité psychique n’est rien d’autre qu’une hypostase que nous collons sur une image du dedans – de dedans du corps, du dedans de la tête, du dedans de moi-même, du dedans d’une intériorité -, une image simplifiante et abusive de toutes ces subtiles manifestations complexes de la modalité de nos énoncés, se distribuant selon un certain type de verbes, dans certains types de contexte, dans des grammaires à chaque fois autonomes, que nous écrasons imaginairement sur l’opposition de ce que j’ai dans la tête et ce qu’il y a dehors et dans l’autre. Ce qui me permet de dire ceci : c’est que la réalité psychique est souvent – en particulier celle que Freud est en train de proposer à son patient – une substance réifiée, d’une réification parfaitement obsessionnelle, puisqu’elle consiste à traiter ce qu’il y a du côté du sujet modal comme une chose, sauf que ce serait une chose que j’ai à l’intérieur de la tête. On parle même de « réalité psychique ».
Cette chose pourrait se montrer au moment où l’homme aux rats est confronté à la transformation horrible de ses pensées en crime. Il pense à un crime, penser à un crime, c’est commettre un crime en pensée, et commettre un crime en pensée, transforme penser en crime. Celui qui a commencé à penser à des choses auxquelles il n’aurait pas dû penser, se rend bien compte qu’il commet en pensée le crime auquel il pense, et que la seule manière d’arrêter de commettre en pensée le crime auquel il pense, c’est de se faire un crime… de penser ! On peut étaler ça sur une came, sur cette représentation de bande de Möbius que je vous avais donnée, mais ça a une consistance qui n’est pas simplement formelle, mais qui est psychologiquement sensible. A quoi savons-nous que nous désirons quelqu’un ou quelque chose ? Eh bien à ce que nous y pensons tout le temps ! Si vous y pensez tout le temps, et si pensez tout le temps à quelque chose à quoi vous n’auriez pas dû penser, vous pouvez parfaitement vous faire un crime et une faute de le penser. Or, ces espèces de transformation du dedans en dehors, où l’objet de la pensée devient une pensée-objet qui en tant que telle devient quelque chose de condamnable, ça aboutit à donner un effet obsessionnel très particulier à la théorie du désir. C’est-à-dire qu’on se construit une réalité psychique qui serait faite de crimes de pensée.
Qu’est-ce que la réalité psychique ? C’est ces crimes de pensée. Et Freud, là, finalement est fidèle à la conclusion de la Traumdeutung. Dans mon commentaire de la Traumdeutung, j’avais montré que dans les derniers paragraphes, où il est question de la fameuse « réalité psychique », il reprend le motif qui est discuté au tout début du livre, des gens qui font des rêves criminels. La question classique de savoir, de quelqu’un qui rêve d’assassiner l’empereur, qu’en fait-on ? Est-ce qu’il n’est qu’un rêveur, et donc on ne lui fait rien, ou bien, ayant quand même rêvé qu’il allait assassiner l’empereur, faut-il quand même l’exécuter ? Si vous faites bien attention, c’est la différence qu’il y a entre « je rêve que l’empereur est assassiné par moi », et « je rêve que l’empereur soit assassiné par moi ». La différence est purement modale. C’est là que se construit la notion de réalité psychique. Si vous dites : « je rêve que l’empereur est assassiné par moi » : indicatif. Qu’est-ce qu’on fait ? Mais le problème est : est-ce qu’on peut construire « je rêve que » avec des phrases indicatives, ou bien est-ce qu’il faut construire « je rêve que » avec des phrases au subjonctif, c’est-à-dire en fait à l’optatif ? Si vous dites « je rêve que l’empereur soit assassiné par moi », c’est un lapsus qui vous coûte la tête. Parce que ça change totalement à la fois le sens de « je rêve que », non pas parce que c’est une autre expression, mais parce que la position subjective est différente.
Donc cette circonscription logico-grammaticale des attitudes non-indicatives, respecte je crois précisément le grain de ce que Freud appelle de ses vœux en ne la construisant pas : une psychologie de l’obsessionnel. Et ça montre l’affinité de la réification du désir et du sujet, avec une théorie obsessionnelle. Pourquoi est-ce que ça aboutit donc à un clivage du moi ? Vous savez que Freud est extrêmement faible là, il le sait, il le dit. Bien sûr que c’est grossier de dire que la mauvaise partie est l’inconscient sexuel infantile, et la bonne partie est la personnalité si mûre, si intelligente, si noble, si adulte… Quelle est la confusion qu’il fait ? La confusion qu’il fait et qu’il injecte à son patient (comme autrefois une certaine « solution » à Irma) est une confusion que peut-être il ne pouvait pas ne pas faire.
*
Vous vous rappelez la phrase de Séglas que je vous avais citée, et que Séglas donne en exemple de ce que c’est que le psychisme de l’obsédé. Il explique qu’un de ses patients lui a dit : « je suis conscient d’un côté que je suis inconscient de l’autre ». Et Séglas conclut son essai sur les obsédés en disant : « on ne peut pas mieux dire ». Ce qui est frappant, c’est que « je suis conscient d’un côté que je suis inconscient de l’autre ». Donc je suis conscient que je suis inconscient, ça consiste à mettre tout du côté de la conscience. Or, c’est exactement ce que demande à faire reconnaître l’homme aux rats, c’est-à-dire qu’il est conscient du fait qu’il a une part de lui-même qui est mauvaise. Ça n’a rigoureusement rien à voir avec la Spaltung d’un inconscient dont vous n’avez aucune conscience. L’inconscient freudien, ce n’est pas un inconscient dont on peut être conscient, sauf quand on rigole entre collègues, et qu’on se dit « ah ! mon inconscient m’a joué un tour ! ». Ça m’a toujours beaucoup frappé les gens qui parlent de leur inconscient, alors que le principe, c’est que c’est votre inconscient qui vous parle, ce n’est pas vous qui parlez de votre inconscient...
Mais ce clivage du moi, je pourrais vous l’illustrer à partir d’un cas récent, est une chose qui m’avait beaucoup frappée. C’est quelqu’un qui comme l’homme aux rats, commence sa séance en me faisant part justement de son effroi de toute activité mentale, disant qu’il y a dans toute activité mentale quelque chose qui l’angoisse, et qui lui fait chercher ce qu’il appelle être un « animal pour soi-même », quelque chose comme une sorte de contact vital qui ne serait pas perdu, où au fond, tout ce dispositif de verbalisations et de pensées qui le traversent s’arrêterait, avec au point extrême d’être un animal pour soi-même, l’angoisse de ne plus s’appartenir. Ce qui veut dire à la fois une expérience de dépersonnalisation, qui est un très puissant symptôme des TOC, soit un tel succès dans l’abolition de toute mentalisation, que finalement il en viendrait à douter de sa propre existence. Et là, il dit cette chose curieuse sur le fait d’être rien : « j’ai cette image de deux parties qu’on décollerait l’une de l’autre ». On décolle deux parties, et au milieu, plus rien ! C’est une béance, c’est le point de béance qui est désigné comme le lieu de son abolition, et en même temps d’une abolition qui ne serait que la sienne, ce qu’il a de plus propre, ce qui est angoissant, puisque c’est le lieu de l’angoisse même du sujet. Et alors, il y a tout un aspect de cette division, qui fait que ça renvoie à une angoisse infantile et un souvenir assez précis d’être dans une pièce noire à côté d’une pièce lumineuse où se trouvent les femmes de la maison, sa mère et ses sœurs. Il est dans le noir, il est fou d’angoisse, et il court se précipiter dans la pièce où il y a les femmes. Ce qui me paraît frappant, c’est que c’est la matrice de cette opposition permanente qu’il y a en lui, entre la part d’ombre, celle qui reste dans la pièce obscure, et puis la part lumineuse, celle qui rejoint les femmes. Et ce clivage est un clivage torturant : « je veux me débarrasser de ma part d’ombre ! ». Ces effets narcissiques, qui sont des effets narcissiques profonds, tenaillants, et qui là arrivent au bout d’une série d’associations, le grand problème, c’est que c’est ceux sur lesquels tout obsédé va revendiquer le contrôle, c’est-à-dire, « mais de cela, je suis conscient, sur cela, vous ne pouvez rien m’apprendre ». Ce qui pose le problème de comprendre comment un moi peut se diviser entre ces deux parts, la sombre et la lumineuse, au terme d’un processus qui lui est effectivement inconscient.
Ce qui pose la question de savoir comment un sujet et un moi s’articulent.
Et là, j’avais pensé ça, un schéma que vous connaissez sans doute, celui de cette histoire de Lacan sur l’empreinte de pied de Robinson sur la plage. Ça ne vous dit rien ? Si ? L’idée est la suivante : là vous avez le pied, là vous avez l’empreinte, là vous avez le relevé de l’empreinte, et là vous avez le moulage qui est fait, c’est-à-dire quelque chose qui est fait comme le pied.
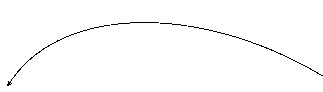
pied
empreinte relevé de moulage
l’empreinte
(sceau)
sujet
moi trace trace de trace
(relevé de la trace comme trace) Qu’est-ce
qu’il s’agit de penser avec ça, qui fait que nous sommes toujours tellement
enclins à prendre notre moi pour notre subjectivité ? Bien sûr, que nous
sommes toujours enclins à prendre notre moi pour notre subjectivité, puisque
notre moi est moulé par l’ensemble des processus signifiants
qui dérive de la relève du sujet forclos dans la chaîne signifiante !
Ce n’est pas du tout par une illusion ou une tromperie idéologique. C’est
que nous n’avons comme moulage du sujet que nous ne sommes plus, que notre
moi. Que sont
chez l’obsessionnel ces formidables effets de clivage ? Chez l’obsessionnel,
la trace ne s’efface jamais, elle n’est jamais relevée
en tant que trace. Pourquoi est-ce que Lady Macbeth se lave sans cesse
les mains de son crime ? Mais c’est parce qu’elle ne peut pas faire de
son crime, le crime qu’il a été, elle ne peut pas faire de son crime, un crime,
donc elle ne peut pas l’assumer, s’en vanter ou se le faire pardonner. Elle
est toujours en train d’effacer le sang qu’elle a sur les mains. Et ce sur
quoi j’insiste, c’est l’impuissance des tautologies effectivement symbolisantes
chez les obsessionnels, leur incapacité à appeler un chat un chat, et à reconnaître
que leur crime est un crime. Si vous faites bien attention, c’est toujours
lié à leur incapacité de manipuler sérieusement des tautologies comme ça,
en sorte que cette tautologie soit une coupure. Ils ne peuvent pas appeler
un chat, un chat, et reconnaître une faute comme une faute. Ils sont toujours
en train d’effacer cette trace. Alors, comme
ils ne peuvent pas effacer cette trace, le moi devient quoi ? La trace
d’une ineffaçable trace. Et le but du moi obsessionnel, c’est de s’effacer,
c’est de s’effacer lui-même partout, ce qui fait que ces sujets obsessionnels
peuvent avoir comme ça comme ambition imaginaire, de ne pas être. Non seulement
de n’y être pour rien, mais de n’être rien nulle part et en tout. Ça, c’est
un temps absolument essentiel de toute névrose obsessionnelle. Mais du coup,
comme on ne peut pas effacer, qu’il n’y a pas de relève possible, eh bien
on ne peut que s’effacer comme mauvais du bon dans lequel on se sauve. On
ne peut s’effacer qu’en se divisant soi-même, en se déchirant soi-même, et
en essayant là où il n’y a pas, ce passage de S1 à S2 qui n’a pas eu lieu.
C’est-à-dire que la trace, on n’arrive jamais à la relever en tant que trace,
à la faire entrer dans un système, où ce qui est perdu, c’est la trace en
tant que trace. Et le pilier évidemment de ça, c’est Φ, c’est la possibilité
d’entrer dans ce système dont le lieu est S2, le signifiant phallique, qui
est le signifiant qui va rendre signifiant les autres signifiants, qui va
assurer l’opérativité signifiante de l’ensemble des signifiants inconscients,
et qui n’est pas lui-même un des signifiants, mais le signifiant absent qui
permet aux autres signifiants d’exercer leur fonction signifiante, leur fonction
de relève de la trace primaire. Comme justement
chez l’obsessionnel, ces choses-là sont définitivement gênées, embarrassées,
vous vous retrouvez avec un moi complètement figé, complètement scindé en
deux, qui est toujours dans le processus d’effacer avec sa partie bonne, sa
partie mauvaise, de lutter à partir de ce qu’il a de bon, contre ce qu’il
a de mauvais. C’est pour ça que je fais de cette division du moi, qui est
devenue sans que j’insiste beaucoup un trait absolument permanent de la littérature
– cette division du moi fut mise en scène dans tout un tas de textes littéraires
au 18ème et 19ème siècle – il y a un temps quand même
essentiel, c’est le temps où le but ultime de l’obsédé serait de s’effacer
définitivement, de n’être pas là, et de désirer n’être rien.
![]() S S1 S2 S3 Sn…
S S1 S2 S3 Sn…
![]()
![]()
![]()