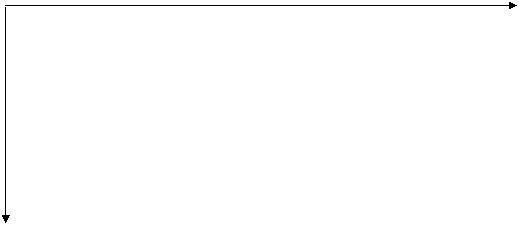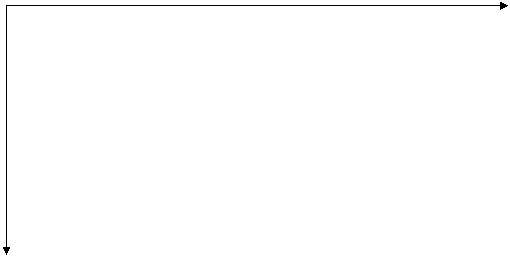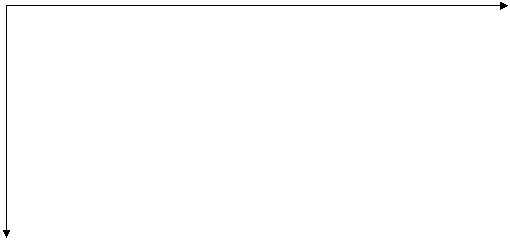LE SUJET ET SON ACTE
1ère séance (25 septembre)
Je
voudrais, comme depuis plusieurs années en fait, prendre mon départ pour le
séminaire de cette année, dans l’expérience de l’angoisse. Puisque, si
j’annonce comme titre « le sujet et son acte », c’est pour pointer
immédiatement le lien très intuitif, qui n’a nullement attendu la psychanalyse
pour être établi, entre l’angoisse et l’acte. Je dirais que l’angoisse, est
certainement quelque chose au départ comme le stigmate de l’acte authentique,
que cet acte d’ailleurs soit effectué ou pas. J’emploie le terme ici de
stigmate pour que soit tout de suite introduite la dimension du poinçon, de la
marque, du côté « entamant » de cet affect au moment même où il
s’agirait de quelque chose comme l’acte avec toute la portée corporelle mais
aussi sociale qu’on imagine. En tout cas, le mot stigmate touche la
chair ; c’est ainsi un moyen de désigner beaucoup plus qu’un simple
critère. S’il y a critère ajouté à la dimension charnelle du stigmate, il faut
bien voir que le critère, au sens de la démarcation conceptuelle, c’est que l’acte
est signifiant. Cette formule – « l’acte est signifiant » – est
quelque chose que je traîne depuis plusieurs années dans ce séminaire parce que
je pense que c’est un des points sur lequel il y a eu une évolution extrêmement
importante de Lacan : un approfondissement de la dimension pratique de ce
qu’est le signifiant. Et lorsqu’il dit que l’acte est signifiant, lorsqu’il dit
que « l’acte est un dire », une forme du dire, c’est vers la précision
de cette notion de signifiant qu’il s’avance. La position d’angoisse dans
laquelle se situe en général le départ de ces recherches que je fais devant
vous – je pense que certains d’entre vous la connaissent -, c’est que j’ai
beaucoup moins de certitude que les psychanalystes sur la pertinence de ce qui
se dit et fait sur leur propre pratique et leur propre acte. La certitude étant
un point sur lequel je crois Lacan dit quelque chose de très important, c’est
que la certitude de l’acte est, dit-il quelque part, « transférée »
de la certitude de l’angoisse, l’angoisse étant cet affect qui comme vous le
savez, ne ment pas.
Cette
angoisse, donc, qui est le point de départ des recherches de cette année,
consiste à prendre très au sérieux les défis qui sont jetés à la position
actuelle du psychanalyste. Parmi ces défis, il y a l’ambition de ne pas dire
n’importe quoi, en disant que c’est de la psychanalyse au motif qu’on est
psychanalyste. Ne pas dire n’importe quoi, implique que ce que dit un
psychanalyste de ce qu’il fait est en soi déjà un acte. Lacan, à des moments
importants des séminaires auxquels je fais allusion en ce moment – le séminaire
sur l’angoisse et le séminaire sur l’acte – se pose la question par rapport à
son enseignement, de savoir en quel sens ce qu’il dit relève de l’acte, est effectivement acte. Et de façon
curieuse – c’est une chose dont je me suis aperçue latéralement -, c’est
toujours dans les moments où il accepte de reconnaître une certaine dose
d’angoisse dans sa position, en particulier sur les séminaires précédemment
cités, contemporains de sa décision comme peut-être vous le savez, d’instituer
une école par un « acte de fondation ». Je vais essayer de ne pas
perdre ce fil conducteur, qui fait que peut-être ce qu’on peut risquer sur le
sujet et son acte me dérange un peu en mettant en question le statut de ce que
je fais ou de ce que je prétends faire.
Ce
que Lacan, dans le séminaire sur « l’acte psychanalytique » se
proposait de faire, c’était d’examiner ce que l’acte psychanalytique, à
supposer qu’il existe, éclairait de l’acte en général.
Alors
le problème qu’il rencontre d’emblée est que si l’on veut faire une chose
pareille, eh bien encore faudrait-il déjà caractériser ce qu’est l’acte en
général. On est en effet bien obligé de le faire, puisque l’acte
psychanalytique serait une espèce de l’acte en général. Et c’est seulement une
fois ceci fait qu’on peut, par une sorte de retournement paradoxal, se demander
si le fait qu’il y ait de la psychanalyse – car il n’y a pas eu de la psychanalyse
à n’importe quelle époque et dans n’importe quelles circonstances – éclairerait
ce qu’il en est de l’acte. On est alors pris dans une sorte de tension,
puisqu’assurément Lacan apporte des choses sur l’acte qui en modifient
fortement la teneur, et qui en étendent de manière originale, je crois, le
concept.
Mais
je vais descendre de choses générales et très philosophiques à des questions
peut-être un peu plus plates, ou en tout cas de base.
Tout
d’abord, si l’on parle du sujet et de son acte en psychanalyse, où y a-t-il
acte en psychanalyse ? Je mets de côté la problématique –j’y reviendrai
bien sûr – de l’acte manqué ou du lapsus, dans la mesure où l’acte manqué n’est
pas quelque chose qui se passe de façon consubstantielle avec l’analyse ou avec
une analyse. On a toujours fait des actes manqués ou repéré des actes manqués
en ne sachant rien du tout de Freud: dans les exemples de Shakespeare que donne
Freud, il est clair qu »on a toujours très bien noté de quoi il s’agit
quand quelqu’un fait une chose à la place d’une autre et l’effet de vérité qui
en ressort. Ce qui implique qu’en réalité, l’acte manqué tel qu’il fonctionne à
l’intérieur de la psychanalyse, formalise quelque chose de tout à fait
particulier par rapport à ce qui est dans la littérature, dans la comédie en
particulier, repéré comme ce dispositif où quelqu’un se trahit ou trahit un de
ses désirs par une opération qui réussit dans le fait qu’une autre est manquée.
Mais
pour aller à l’acte plus spécifiquement psychanalytique, un premier degré, je
crois, manifeste et constitutif pour la psychanalyse, est l’idée que le
transfert serait, selon la formule de Lacan, « la mise en acte de
l’inconscient ». Autrement dit, s’il y a psychanalyse, c’est parce que le
transfert met en acte - quelque soit la signification que l’on donne à ce
syntagme - l’inconscient comme dimension, dimension qui ne saurait donc exister
en dehors de celle du transfert et d’un transfert qui en plus est mis en acte.
C’est une première dimension sur laquelle je travaillerai bien évidemment en
détail.
Elle
est paradoxale si on la rapporte à une autre dimension qui est celle de
l’entrée en analyse. Quel est le premier acte dont il y a à prendre acte quand
on est psychanalyste ? C’est évidemment que quelqu’un décide comme ça de
venir demander quelque chose dont il n’a
pas idée – ça c’est une chose absolument certaine – et dont la nature – je
traite ici la demande et l’entrée en analyse comme si c’était la même chose -
peut être extrêmement problématique et pas forcément dépourvue d’une qualité
symptomatique particulière.
Un
des autres actes auquel on pense et qui est évidemment à l’esprit de Lacan
quand il énumère toutes ces choses-là, c’est l’installation du psychanalyste,
quand quelqu’un commence à dire « je suis analyste et je voudrais
qu’on m’adresse des patients », quand il décide par exemple quand il est
psychiatre ou médecin de répondre tout à coup dans un tout autre registre que
celui du psychiatre ou du médecin à la plainte qui lui est adressée. D’autant
que Lacan n’y va pas de main morte, et ose qualifier de « passage à l’acte
éclairé », mais de passage à l’acte tout de même, cette chose qui consiste
à s’installer comme analyste.
Une
autre dimension encore, qu’il ne faut pas négliger, et qui rend problématique
la question de l’acte en psychanalyse, c’est qu’il y a une longue tradition,
disons, prophylactique, qui à mon avis remonte au moins à Fenichel, qui
consiste à faire de l’abstention de tout acte un réquisit de l’analyse. Je ne
suis pas certain que tous ici se soient fait demander cela lors de leur cure,
mais c’était par exemple extrêmement formalisé dans le travail personnel jusque
dans les années 60 ou 70. L’abstention de tout acte - on ne se marie pas,
on ne change pas de métier, etc., - pouvait être explicité comme tel en même
temps que la règle fondamentale dans certaines pratiques. Je sais qu’aux
Etats-Unis, un certain nombre de praticiens de l’IPA maintiennent fermement
cette dimension de l’abstention de tout acte énoncée en même temps que la règle
fondamentale.
J’ajoute
encore pour avancer dans ces concepts qui ont été soit forgés soit profondément
modifiés par la psychanalyse et qui ont trait à sa substance théorique, la
question de l’acting out. Qu’est-ce
que c’est qu’un acting out, qu’est-ce
que c’est que ce type de comportement qu’on observe en rapport fort souvent
avec les interprétations considérées comme malheureuses et dont on trouve des
expressions plus ou moins savoureuses dans la littérature : le patient de
Kris par exemple qui se croit plagiaire et qui va manger des cervelles ?
Il y en a d’autres dont on parle beaucoup moins, même si dans la littérature
professionnelle, l’acting out a
toujours un côté un peu drôle, un peu farce et un peu comique. Ceux dont on
parle entre collègues sont parfois nettement drôles.
Ce
qui est beaucoup moins drôle en général, c’est le passage à l’acte. Les
patients qui se suicident en analyse, ça arrive. Et puis, il y a toute la
dimension d’éclairement du passage à l’acte qui est un concept utilisé en
psychiatrie comme vous le savez, éclairement qu’il reçoit une fois inscrit dans
des coordonnées où l’on tient compte de l’inconscient. Le passage à l’acte
étant dans la psychiatrie classique considéré comme une sorte d’effondrement
d’un niveau de contrôle avec libération de quelque chose en dessous, qui fait
qu’il y a précipitation d’un acte. J’emploie très précisément ces idées
d’effondrement ou de liquidation d’un niveau de contrôle avec libération d’un
niveau inférieur qui était contrôlé, parce que Lacan a pendant très longtemps discuté,
sinon bataillé, avec une théorie qui était celle de Henry Ey, qu’on appelle
l’organo-dynamisme, qui puisait dans ce genre de phénomènes une sorte de
validité phénoménale immédiate qui fait que le suicide du schizophrène, ou le
crime du schizophrène par exemple, ou bien certains épisodes maniaques sont
facilement descriptibles comme quelque chose de l’ordre d’un niveau de contrôle
qui défaille, avec « libération » d’un niveau inférieur. Dans le
détail clinique, il est difficile de renoncer à l’idée que le passage à l’acte
serait comme ça une libération d’énergie suite à la faillite d’un niveau de
contrôle. Penser le passage à l’acte en termes psychanalytiques, et précisément
ces passages à l’acte bien connus des psychiatres, est en réalité fort difficile,
et ça nous fera bien sentir quand on s’y essaiera, la modification du cadre que
tout ceci impose.
Enfin,
ça n’a aucun rapport avec l’analyse, puisque l’analyse avec ce type de sujet
est presque systématiquement impossible, mais je vous rappelle que l’acte, en
tout cas en psychopathologie, intervient encore dans une autre dimension
extrême qui à mon avis n’est pas du tout sans rapport, qui est le phénomène des
« actes imposés » dans la psychose, avec le paradoxe dans les
syndromes d’influence, comme on dit aujourd’hui, de ces gens qui vous
expliquent qu’en fait « on » les bouge, « on » leur bouge
le bras, « on » les agit et leur fait faire quelque chose de ce
genre-là. Les actes imposés peuvent être aussi bien des actes entrés dans une
routine motrice – ce qui a fait parlé d’automatisme mental moteur, par exemple
chez Clérambault – ou encore poser des problèmes médico-légaux, lorsque c’est
beaucoup plus qu’un geste, et que ça devient un geste qui a des conséquences
criminelles, comme poignarder quelqu’un ou se livrer à des violences sur une
personne. Avec la question de savoir si c’est là une forme de passage à l’acte,
ou bien s’il y a dans la psychose un rapport à l’acte particulier, où
l’automatisme mental serait dans un continuum particulier. C’est une question
qui n’a de sens bien sûr qu’à être mobilisée comme une contre-épreuve par
rapport à ce que nous pourrions dire de certains passages à l’acte ou de
certains agieren, certains agir à
l’intérieur de ce qui nous est plus accessible, c’est-à-dire des patients
psychotiques ou névrosés, ou bien sûr pervers, qu’il nous arrive de croiser. Je
terminerai sur une question complètement ouverte : est-ce que
l’interprétation du psychanalyste est un acte ? Est-ce l’acte le plus pur
du psychanalyste, ou au contraire y a-t-il une polarité particulière faisant
que l’interprétation serait du côté le plus opposé à ce qui est l’acte ?
Je crois qu’il s’agit aussi d’une question qui doit apparaître sur la table.
Dans les années où Lacan a mis ces choses-là sur la table, il s’agissait, je
l’ai dit tout à l’heure, en même temps de penser à l’acte de fondation d’une
Ecole, et de faire reposer en particulier cette nouvelle Ecole sur
l’élucidation de ce que Lacan identifiait tout à fait comme étant de l’ordre de
l’acte, et qu’il appelait la passe, c’est-à-dire le passage à l’analyste qui
est « passage à l’acte éclairé » dans certaines formules qu’il donne
dans ces années 64-65.
Je
reviens à ce que je disais tout à l’heure, et qui est le petit point d’angoisse
– petit, je vous rassure – auquel j’en reviens toujours quand j’essaie de
donner à ce que je vous raconte une autre allure. Le fait que la question de
l’acte se soit posée à ce moment-là - par rapport à un enseignement, par
rapport à la tentative de définir effectivement ce que c’est que de devenir
analyste, à quel titre, de quoi s’autorise-t-on pour une chose pareille –
est-ce une question historique ou un point structurel ? A chaque fois, si
l’on prend la responsabilité de quelque chose qui ressemble au moins à un enseignement,
on est bien obligé de se confronter à cette difficulté. Alors, il y a les
finauds qui vous diront que justement, traiter la chose comme une question de
structure, c’est historiquement daté, et que nous n’en sommes plus là. En
particulier, les finauds sont ceux qui savent bien que si l’on commence à poser
ce genre de questions, eh bien, les grandes questions font de grands dégâts.
Pour tous ceux qui se posent la question de l’acte psychanalytique en incluant
à l’intérieur la question de savoir ce qui fait qu’Untel devient analyste, et
que Bidule ne le devient pas, eh bien, en général, ça se termine mal. La façon
ordinaire de mal se terminer, c’est de fabriquer des nouveaux stéréotypes de ce
qu’est qu’un analyste, c’est-à-dire de produire une nouvelle image sociale de
ce qu’il convient de faire, de dire, de penser et de croire quand on est
analyste. Malheureusement, il semble que beaucoup de gens aient énormément
souffert du type de question qu’on se pose là si on la prend véritablement au
sérieux, c’est-à-dire quand on se demande si ce qu’on fait est bien de
l’analyse ou pas, si on a effectivement quelque chose dans ses actes ou dans sa
pratique qui est de l’ordre de l’analyse, etc. Ces questions, quand on commence
à les poser de façon systématique et ordonnée, ont un effet assurément
dévastateur sur pas mal de gens. Parce que qu’est-ce que ça fait
apparaître ? Eh bien ça peut faire apparaître de l’inhibition, des
empêchements, de l’embarras, éventuellement des acting out, et parfois, certains ont payé de leur vie ce type de
questions, des suicides, dans le milieu de l’école de Lacan, et en tout cas
pour tout le monde de l’angoisse. Pour tout le monde.
Je
n’ai pas de réponse particulière à ça. Ces grandes questions, ce n’est pas moi
qui les pose, car elles se posent à tout le monde. On a quand même en même
temps l’impression que si l’on peut absolument s’éviter ce type de remise en
cause, être analyste, c’est du flan. S’il n’y a pas à un moment quelque chose
de cet ordre-là, y répondrait-on de façon symptomatique par des identifications
imaginaires, alors ce que nous faisons ici, ce n’est rien. Je le dis d’autant
plus que, comme il y a ici des nouveaux venus et des gens un peu plus jeunes
que moi, vous savez qu’il y a un problème générationnel, que le genre de certitude
des quinquagénaires dans le métier à l’égard de ce que c’est que l’analyse, et
du fait que ça ne pose pas autant de problème que ça, est étroitement lié
qu’ils le veuillent ou pas à un certain contexte social. Le fait qu’il y ait
finalement si peu de demandes
d’analyse, que l’analyse pèse si peu
et fasse finalement de manière extrêmement sensible très peu de différence là où on avait l’habitude qu’elle en fasse,
par exemple dans le champ culturel ou dans le champ scientifique il y a
simplement vingt ou trente ans, est souvent vécu dans le milieu analytique
contemporain comme une sorte d’insupportable sentiment de décadence. Vous avez
là – je dis ça précisément à ceux qui sont plus jeunes que moi – tout un
discours typique des groupes vieillissants, sinon en voie de sénescence
accélérée. Néanmoins, pour ceux d’entre vous qui sont assez travaillés par leur
cure ou par leur pratique pour s’installer comme analystes, la question du peu
de demandes de psychanalyse, la question de la position défensive dans laquelle
on est rapidement acculée dans le milieu professionnel, dans le milieu médical
quand on est un peu trop visiblement travaillé par ce désir d’analyse, fait
partie de coordonnées sur lesquelles je crois on ne peut pas passer comme s’il
ne s’agissait de rien. Ça nous renvoie à ce que quelques-uns ici m’ont déjà
fait remarquer, c’est que dans ce groupe, le séminaire auquel vous assistez –
je ne sais pas d’ailleurs s’il ne convient pas d’arrêter le magnétophone pour
le dire – est le seul où il y a des jeunes. La moyenne d’âge ici, c’est dix à
quinze ans de moins que dans les autres séminaires.
C’est
donc pour ça que j’oriente cette année sur ce thème du sujet et de l’acte, à
cause des entretiens que j’ai eu avec quelques-uns d’entre vous.
Je
vais maintenant vous apporter la thèse que défend Lacan, et sur laquelle je
crois il n’a jamais varié. Et c’est rare, une thèse de Lacan sur laquelle il ne
varie jamais, et où il ne dit pas le contraire six mois plus tard. Il y en a
quelques-unes. Il y en a une qui est extrêmement ferme, chez Lacan, c’est que
« l’acte du psychanalyste, c’est de poser l’inconscient ». J’ai eu
beau compulser pour préparer mon travail toute sorte de séminaires, je ne l’ai
jamais vu revenir sur cette idée : « l’acte du psychanalyste, c’est
de poser l’inconscient ». En revanche, ce sur quoi il revient abondamment,
c’est sur la définition du transfert comme « mise en acte de
l’inconscient », qu’il qualifie de formule préliminaire, approximative,
préparatoire, etc. Effectivement, dans la mesure où l’on ne sait pas ce qu’est
un acte, la « mise en acte de l’inconscient », ça ne coûte pas cher,
et ça fait toujours de l’effet. Ce qui me paraît fort, dans la thèse selon
laquelle « l’acte du psychanalyste, c’est de poser l’inconscient »,
c’est que c’est la position d’une répétition, et la répétition d’un acte
fondateur tout simple, qui est celui de Freud. La première chose que fait Freud
et ce en quoi effectivement Freud est le premier psychanalyste, c’est qu’il
pose l’inconscient. Et poser l’inconscient, ce n’est pas en poser le concept.
Poser l’inconscient, c’est dans le transfert, considérer que le transfert n’a
ses coordonnées et ne trouve ses véritables coordonnées que si l’on fait cette
hypothèse de l’inconscient. C’est-à-dire que c’est non pas une autre manière de
penser la relation entre ce qui est conscient et ce qui ne l’est pas, mais une
autre manière d’écouter les gens qui parlent. C’est une autre manière de juger
de leurs actes. Il y a des versions plus ou moins molles de l’idée de cette répétition
de la fondation. La première fois de votre vie où vous vous asseyez dans un
fauteuil et où quelqu’un sur un divan se met à déblatérer toutes les belles
choses qui font le contenu d’une analyse, et qu’on commence à attraper ceci ou
cela au vol, voire à interpréter, il y a ce moment de frisson qui consiste à
dire : mais en quoi ça ressemble à
ce que Freud a fait ?
Il
y a beaucoup de dangers, là. Un des dangers importants qui se répand
malheureusement toujours du fait des formations d’analystes, consiste à dire à
chacun qu’il lui faut réinventer la
psychanalyse. Ben voyons, comme si c’était à la portée de tout le monde de
réinventer la psychanalyse ! Je vous ferais remarquer qu’en disant que
l’essence de la psychanalyse est de poser l’inconscient, Lacan se garde bien de
formuler cette exigence de réinvention totalement exorbitante à laquelle serait
soumis les individus, et qui vous montre le degré d’aliénation extraordinaire
que certaines formules imposent aux praticiens qui commencent. Déjà poser l’inconscient,
c’est suffisamment délicat comme ça pour qu’on n’ait pas en plus à se fabriquer
quelque chose qui est quoi, sinon le clone d’une histoire hagiographique de la
psychanalyse et de la découverte de l’inconscient par Freud comme une sorte de
geste héroïque moderne. Nous serions tous censés être des héros modernes… Ne
reculant décidément devant rien ce soir, je profite de cette occasion pour vous
dire à quel point je doute de ce qui se pratique autour de moi touchant, pour
la formation des analystes, et en particulier dans ma propre Association, sur
certaines figures, formes ou procédés de l’institutionnalisation de la
transmission, c’est-à-dire de la façon dont des Associations, des Ecoles,
peuvent se dire qu’au fond, on va apprendre aux gens de quoi il retourne. Parce
que tout cela installe irrésistiblement chacun dans une position mimétique. On
peut par exemple très bien imiter le genre d’analyste qu’on a eu soi-même. Ça
ne dure pas forcément très longtemps. Je crois que ce qui fait la force de la position
de Lacan et de la formule « l’acte du psychanalyste, c’est de poser
l’inconscient », c’est que ça veut dire quoi, tel que Lacan le dit ?
Ça veut dire qu’il y a un discours psychanalytique, et que ce discours
s’articule de façon extrêmement rigoureuse à d’autres ordres de discours. Et
c’est cette articulation rigoureuse d’un discours à un autre –
psychiatrique et philosophique pour prendre les repères que j’ai souvent – qui
nous montre ce que c’est que l’acte de poser l’inconscient, c’est-à-dire le
type de déplacement en quoi ça peut authentiquement consister.
Est-ce
quelque chose de théorique ? Oui, il y a certainement une grande attention
à donner du coup à la différence que fait le point de vue psychanalytique par
rapport au point de vue psychiatrique ou philosophique, ou juridique ou Dieu
sait quoi. Et notamment, par rapport à ce qui serait comme ça le discours de la
science, qui comme vous le savez, Lacan l’a martelé, est totalement muet sur ce
qu’il en est de l’acte. La science ne dit rien de l’acte, et l’abandonne à la
morale privée, l’éthique individuelle. En revanche, elle dessine un paysage
dans lequel beaucoup d’actes deviennent pour chacun d’entre nous extrêmement
tentants. C’est un aspect qu’il ne faut jamais négliger : la source de toutes
les tentations les plus inquiétantes, aujourd’hui – ce qui fait qu’il y a
toujours des grands savants qui sont des « grandes consciences »,
comme on dit, surtout ceux qui ont fabriqué la bombe atomique et qui ont permis
qu’elle saute sur les Japonais -, c’est bien la science. Cela dit, ça vous
laisse totalement nu devant votre acte, devant ce qui est la responsabilité qui
s’y attache. Que ce soit théorique c’est vrai, mais « poser
l’inconscient » c’est poser l’inconscient par rapport à des discours et à
des organisations pratiques, des institutions. C’est la façon dont s’articulent
ces discours qui à mon sens peut témoigner, purement témoigner, rien prouver
mais témoigner, qu’il y a bien de l’inconscient qui est posé.
Est-ce
la seule manière de faire ?
Je
n’en sais rien, mais je crois tout à fait que cette articulation des discours
est un procédé relativement transmissible qui n’est pas complètement déplacé
par rapport à ce que peut être un enseignement par exemple, où vous pouvez
avoir une petite idée de ce que serait l’acte psychanalytique.
Je
voudrais me livrer aussi avant d’avancer plus loin à quelques remarques sur les
autres occurrences de l’acte moins formidables que le transfert et la mise en
acte de l’inconscient et que j’évoquais tout à l’heure, en faisant quelques
remarques en particulier sur la fameuse injonction d’abstention. Pour autant
que je me rappelle, mon analyste ne m’a jamais demandé de ne rien faire de
grave, de ne pas… etc. Et ce n’est pas non plus mon habitude. Dans la pratique
contemporaine, autant qu’on m’en ait dit quelque chose, très peu de
psychanalystes réclament cette abstention, sauf cas véritablement tout à fait
spéciaux, par exemple avec les toxicomanes, et encore si l’on peut non pas le
faire jouer comme une condition de l’analyse, mais comme une intervention, se
distinguant de l’interprétation. Alors, pourquoi l’injonction de s’abstenir de
tout acte est-elle tombée en désuétude ? J’ai beaucoup d’hypothèses. La
première, c’est qu’on peut compter sur une chose, c’est que de toute façon, les
actes sont rares. Comme ils sont le plus souvent ratés et que l’inhibition
domine largement... Il suffit, comme vous le savez de dire à quelqu’un qu’il
peut faire ce qu’il veut relativement à ce qui agite son désir, pour être sûr
qu’il ne fera rien. Une question que je me suis souvent posée, est de savoir si
les analystes qui font de l’abstention de tout acte une obligation, interdisent
les actes sexuels ? Il me semble que non. En même temps, on pourrait tout
à fait se dire, que vu ce que la psychanalyse raconte sur la sexualité, c’est
bien curieux. Ça devrait être au moins une question qui se pose. Néanmoins,
blague à part, il y a tout de même une question, qui est de savoir comment
penser la raréfaction de l’atmosphère tout à fait particulière dans une séance,
qui fait que si l’abstention n’est pas forcément exigible ou demandée, il y a
tout à fait des actes qui ne se produisent pas, dans une séance d’analyse.
Quelque chose de l’ordre de la raréfaction de l’atmosphère se produit, et est,
sans qu’il y ait de conflit entre Ecoles à cet égard, une condition de
l’analyse.
C’est
une difficulté. Elle est à mettre en rapport avec une chose paradoxale :
c’est qu’à la fois on pourrait considérer qu’il faudrait s’abstenir de tout
acte - Freud le dit comme ça dans sa correspondance et quelquefois par moment
dans certains textes théoriques -, alors qu’en même temps la psychanalyse
inversement ne fonctionne que si tout ce que vous dites et tout ce que vous
faites, même ce que les gens font une fois la séance terminée sur le pas de la
porte, etc., fait partie de la séance, et en fait intrinsèquement partie. Que
si tout est acte, en somme. Car la structure essentielle de l’acte,
c’est son imputabilité subjective. Il y a des tas de choses dont vous ne voulez
absolument pas que ce soit tenu pour des actes, mais qui néanmoins sont pris
comme des actes par autrui. Prendre acte de quelque chose, ne veut pas dire que
celui qui a agi ait voulu faire un acte, poser un acte. Mais néanmoins, il n’y
a pas d’analyse possible si on ne prend pas acte de tout ce qui a été dit et
fait, aussi bien d’ailleurs par le patient que par l’analyste. Ce qui fait que
l’anodin, le dit « il y a fort longtemps », sont élevées à la dignité
de manifestations subjectives bien au-delà de ce que, sur le moment, on aurait
voulu.
Ça
pose un problème très simple : est-ce que prendre acte, ce n’est pas une
certaine manière – que je crois erronée, mais qui joue dans toute analyse – de
traiter la parole de l’analysant comme de l’écrit ? Si vous prenez acte,
pourquoi est-ce qu’au fond on ne retomberait pas sur les deux dimensions de
l’acte, en droit ? L’acte juridique en droit a une forme et un
fond. La forme de l’acte, l’instrumentum,
en particulier en droit français, c’est l’écrit. En droit français, les actes
écrits priment sur tout ce qui pourrait être de l’ordre du témoignage oral, ce
qui n’est pas le cas dans d’autres systèmes de procédure. En France, l’acte par
excellence, l’acte de décès, l’acte de donation, etc., c’est de l’écrit. Du
côté de la forme, ce qu’on appelle le negotium,
un acte est simplement défini comme une manifestation de la volonté qui
entraîne des conséquences de droit. Quelqu’un vous dit quelque chose
« comme ça », il ne voudrait pas que ça ait beaucoup d’importance, et
vous pouvez lui dire : « dont acte ». C’est-à-dire :
« toi mon coco, j’oublierai pas ce que tu viens de dire, et déjà, je te
l’impute ». Donc l’acte juridique a une double portée. C’est un moyen
d’imputer des engagements et de mettre sous le nez de la personne non pas ce à
quoi vous pensez, mais ce qu’il a écrit (encore que la dimension de mettre
quelque chose sous le nez de quelqu’un ait le petit parfum anal qui convient,
avec l’écriture, la trace, etc.). D’autre part, et c’est une chose extrêmement
importante dans le droit, c’est que ça s’intègre à une hiérarchie. En
particulier, il y a une école en droit qui est l’école de Bordeaux, qui était
animée par le doyen Duguit, qui a tenté de systématiser l’édifice entier du
droit autour de la notion d’acte. C’est la notion d’acte qui permet de penser
systématiquement le droit. Le fait qu’effectivement vous ayez cette dimension
d’imputation et de coinçage du sujet par le biais de l’acte, et que ce coinçage
ait une dimension rationnelle puissante se traduisant dans la vie des Etats et
des administrations, n’en fait peut-être pas un bon modèle pour penser l’acte
analytique. Et pourtant, ça fait bien apparaître le rapport de l’acte à la loi
et à l’ordre.
Je
clos ces remarques sur le problème de savoir ce qui se passe quand on prend
acte de ce que quelqu’un dit et puis des limites qu’on pourrait vite
rencontrer, de l’extrême difficulté d’ajuster ce que c’est que « prendre
acte » en analyste. A la limite, vous voyez comment un dispositif
analytique pourrait devenir persécuteur, et persécuteur au sens strict, capable
de faire déjanter un psychotique, dans une certaine manière de prendre acte des
paroles.
Je
clos ce chapitre pour essayer de vous introduire à la problématique globale –
je l’ai dit, ce soir je ne recule devant rien – de ce que je voudrais vous
raconter cette année. J’ai évoqué deux séminaires de Lacan, parce que je crois
qu’il y a une tension liée aux rapports de l’angoisse et de l’acte, à
l’intérieur de la conception de Lacan, et que cette tension est absolument
essentielle à la psychanalyse elle-même. Elle concerne sa possibilité d’exister
et de s’articuler par exemple au discours psychiatrique ou philosophique, ou
juridique, etc. C’est qu’un acte, dans ce que ça enveloppe par exemple de
dimension éthique, est une action – c’est une formule de Lacan que je vous cite
là – « un acte est une action en tant que s’y manifeste le désir même qui
aurait été fait pour l’inhiber ». Ce qu’on peut capter effectivement de
l’acte, c’est que c’est une action – ça ne veut pas dire qu’on sait ce qu’est
une action – « en tant que s’y manifeste le désir même qui aurait été fait
pour l’inhiber ». Il est très clair que le conditionnel irréel « qui
aurait été fait » définit une certaine dimension qui apparaît à l’horizon
de l’acte, et qui est la dimension de la capture narcissique. Chaque fois qu’il
nous est donné de faire une déclaration d’amour – pour prendre un modèle d’acte
-, il est clair que ça ne s’épuise pas à une action, mais que ça implique
quelque chose comme le franchissement d’une sécurité et d’une image qui n’est
rien d’autre que l’image de soi dont on fait trembler les bords. Ce rapport au
tremblement de l’image narcissique vous indique de façon crue ce qui peut se
passer dans certains déclenchements de psychose. C’est-à-dire que, dès que vous
avez cet horizon de l’inhibition franchie, tous ceux qui n’avaient pour eux que
de se reposer sur la stabilité imaginaire de leur image, la traverse dans
l’acte pour se retrouver dans la folie. Il y a un certain nombre d’actes qui
peuvent, précisément à cause de ce jeu interne entre le désir et le
« désir même qui aurait été fait pour l’inhiber » - la capture
narcissique – se révéler périlleux. Ceci vous montre en passant qu’il n’y a pas
de différence de qualité entre l’angoisse psychotique et l’angoisse
névrotique : l’acte est périlleux pour tout le monde.
Ce
« désir même qui aurait été fait pour l’inhiber » indique à quel
point quelque chose comme le fameux objet (a) est poussé dans le champ de
l’Autre. C’est quelque chose où l’objet cause du désir est poussé dans le champ
de l’Autre, plus loin, ce qui implique « surmontement » de
l’angoisse. Qu’est-ce que je veux dire par « poussé au-delà d’une certaine
limite » ? Probablement ce qui rapproche quelque chose comme écrire
son testament et faire une déclaration d’amour, pour prendre deux actes. Ecrire
son testament – vous savez qu’il y a des gens qui sont absolument incapables
d’écrire un testament, et que ça peut même être l’objet d’une demande d’analyse
à cause d’une inhibition foudroyante, ou encore que ça peut être un motif
d’entrée en analyse que d’apprendre que ses parents ont écrit un testament-,
c’est s’installer de l’autre côté de la position narcissique qu’il occupe, et
pousse dans son acte le bouchon au-delà des limites de son propre narcissisme,
de son moi vivant.
Si
je reprends cette formule, qu’un « acte est une action en tant que s’y
manifeste le désir même qui aurait été fait pour l’inhiber », c’est que le
problème fondamental est de coordonner l’acte et l’action. Est-ce que pour
qu’il y ait acte, il faut qu’il y ait action ?
C’est
là qu’on ne peut pas éviter un peu de clarification conceptuelle ou
philosophique. L’action a des effets dans la réalité. C’est quelque chose qui
se rapporte à la réalité. L’action, c’est faire en sorte que les intentions
aient des effets naturels, des effets dans la nature, c’est-à-dire qu’elles
entrent dans la chaîne des causes et des effets. Si l’action est devenue ce
concept complètement dévorant dans la philosophie contemporaine, en particulier
dans la philosophie analytique et la philosophie de l’esprit et dans le support
qu’elle offre aujourd’hui aux sciences cognitives par exemple, c’est parce que
l’action est la charnière entre ce qui est du domaine de l’esprit d’un
côté, des intentions, des motifs, des raisons, et de l’autre la réalisation –
c’est pour ça que je parlais de la réalité -, l’« effectuation » de
cette intentionnalité dans ce qui est objectivable, mesurable et quantifiable,
et qui est la nature. Avec le rêve - dont vous connaissez certainement un
certain nombre de manifestations à travers le succès médiatique du paradigme
des neurosciences - qu’en comprenant ce qu’il en est du mécanisme de l’action,
on pourrait donner une explication scientifique du fonctionnement mental,
c’est-à-dire de la réalisation de ce qui est l’ordre de la sphère des
intentions, des motifs, des raisons, des croyances, etc.
Ce
paradigme de l’action, on n’a pas attendu les sciences cognitives pour le
mettre au premier plan. Ce paradigme de l’action, c’est le paradigme freudien,
c’est le paradigme de toute psychologie scientifique déjà avant Freud. Au sens
où, je vous le rappelle parce que je reviendrai longuement sur ce thème,
« le rêve remplace l’action », dit Freud, s’insérant en cela dans le
débat psychologique scientifique de son époque, et probablement aussi de la
nôtre. Bien avant d’entrer dans la dimension du rêve et de son lien avec un
désir inconscient et refoulé, l’idée même de désir suppose que le rêve remplace
l’action et qu’il manifeste en quelque sorte l’intentionnalité subjective sans la réalisation de l’intention,
pourquoi ? Parce que quand on dort, il y a inhibition motrice. C’est parce
qu’il y a cette inhibition motrice dans le sommeil, nous raconte Freud, que
quelque chose de plus libre se manifeste, exprimant des dispositions et les
intentions du dormeur. Ce sont ces dispositions et intentions du sujet dormant
qui sont comprises comme des désirs.
Donc
le paradigme de l’action est un paradigme fondateur dans la conception de la
psychanalyse, et si elle est traitée à l’époque de Freud à travers la métaphore
de l’acte réflexe sur lequel je reviendrai – ça rentre d’un côté et ça sort de
l’autre, et au milieu se passe toute sorte de choses très compliquées dans
l’appareil ψ – et si ce paradigme est repris aujourd’hui d’une façon
fondamentalement homogène dans les sciences cognitives, ça risque de nous faire
oublier un autre aspect absolument essentiel qui est lié lui exclusivement à
l’acte, en tant que l’acte se distingue radicalement de l’action. C’est que
l’acte est entièrement pris non pas dans des coordonnées naturelles, mais dans
des coordonnées langagières. Ça peut être uniquement le déplacement d’une
position subjective, d’une case à une autre dans un espace symbolique, ou de
pur langage. Voilà une notion qui me plaît beaucoup, car en plus elle concerne
cet objet (a) par excellence qu’est le parapluie : c’est l’acte
« non-acte ». Un exemple d’acte non-acte en droit est la perte d’un
parapluie. Au bout d’un an et d’un jour, que vous sachiez que vous avez perdu
un parapluie ou que vous ne le sachiez pas, celui qui a trouvé votre parapluie
en est désormais le propriétaire, à la condition qu’il aille le réclamer avec
son reçu rue des Morillons. L’acte non-acte, c’est quelque chose qui fait que
vous ne savez peut-être même pas que vous avez perdu votre parapluie et que
quelqu’un l’a trouvé, mais le transfert de propriété s’effectue alors même que
vous ne faites rigoureusement rien. On ne pas dire qu’il y a la moindre action.
Il n’y a pas la moindre action qui est faite d’aucune manière, et néanmoins, on
prend acte du fait qu’au bout d’un an, le parapluie a changé de propriétaire.
Et la personne qui a trouvé le parapluie est tout aussi propriétaire, au bout
d’un an et un jour, que si elle l’avait acheté. C’est une dimension de l’acte
qui est parfaitement repérée par le droit, et qui est absolument formelle, qui
n’a rien à voir avec un déplacement matériel quelconque dans la nature. C’est
un pur changement de statut qui s’inscrit dans une dimension symbolique où une
opération entièrement symbolique est effectuée sans qu’il y ait quoique ce soit
qui ce soit passé dans l’ordre de la nature, y compris, et j’insiste, la
moindre activation neuronale chez l’un ou chez l’autre acteurs de cette saynète
au parapluie.
Le
deuxième point que je crois important, c’est que la tentation d’essayer de
naturaliser au sens fort la théorie psychanalytique, en la rattachant au grand
paradigme de la psychologie scientifique de la théorie de l’action – parce que
l’action c’est intuitif, ça nous permet d’articuler ce qui est du côté de
l’esprit et ce qui est du côté de la nature : quand je prends ma montre,
je provoque des causes et des effets dans l’ordre de la nature, et néanmoins si
je les provoque c’est parce qu’il y a des choses mentales qui se sont passées
en amont, et qui sont mises en communication avec les choses naturelles par
cette action –, cette tentation risque de nous faire oublier un point
essentiel, qui est que quand on parle de la cause de l’acte, on parle de
tout à fait autre chose que de la cause de l’action. C’est que la cause
de l’acte ne doit pas faire oublier, que le désir qui se met en place dans
l’acte demeure justement complètement ineffectué. Et le désir ineffectué
est autre chose que ce qui est effectué comme action. Autrement dit, dans un
acte, quelque chose du désir apparaît, qui n’est pas son incomplétude, mais qui
est le fait qu’il n’a rien à voir avec son effectuation et qu’il se préservera
ineffectué à travers tout l’acte. Chose qui n’existe pas quand vous traitez le
désir, en un sens affaibli et comme châtré, comme un moyen de rendre raison de
l’action qui est effectuée. Pourquoi par exemple l’acte sexuel est-il autre
chose que ce que les sexologues proposent de rafistoler, et qui est l’action
sexuelle ? Parce que justement dans l’acte sexuel, qui est pourtant
quelque chose qui se consomme, le désir qui est en cause dans cet acte reste
ineffectué. Il est d’un tout autre ordre, ce désir, que celui qu’on va dans une
conceptualité philosophique un peu différente, admettre comme une des
« raisons motivantes » de l’action.
Je
voudrai vous lire un texte important sur lequel on reviendra d’Elizabeth
Anscombe, une élève de Wittgenstein, qui se trouve heureusement traduit en
français récemment, et par lequel je voudrais vous faire sentir combien les
penseurs de l’action, les grands penseurs de l’action comme Anscombe, comme
Davidson dont je parlerai plus tard cette année, ont pu rencontrer ce type de
difficultés. C’est-à-dire qu’assurément on a l’impression de savoir quels bords
a une action, comment « c’est fichu », alors qu’en fait c’est
tellement pris dans le langage, au bord où ça commence à faire acte, que tout
ce qu’on espère pouvoir capter grâce au concept d’action donne l’impression de
s’évanouir et de poser un nombre incroyable de problèmes. Voici ce qu’Elizabeth
Anscombe écrit dans un des paragraphes les plus célèbres de la philosophie
analytique qui est le §23 de Intention :
«
Soit la question : « Lorsqu’une action intentionnelle a lieu, existe-t-il
une description qui soit la description de cette
action ? » Considérons une situation concrète. Un homme pompe de
l’eau dans la citerne qui alimente une maison. Quelqu’un a trouvé le moyen de
contaminer systématiquement la source avec un poison mortel qui agit de façon
cumulative et telle que ses effets ne se manifestent que lorsqu’il est trop
tard pour les soigner. La maison est régulièrement occupée par un petit groupe
de chefs d’un parti politique accompagnés de leur famille proche ; ils contrôlent
un grand pays, sont engagés dans l’extermination des Juifs et préparent
peut-être même une guerre mondiale. L’homme qui a contaminé la source a calculé
que, si ces gens étaient éliminés, des hommes de bien arriveraient au pouvoir
qui gouverneraient bien, ou même qui institueraient le Royaume des Cieux sur la
Terre, et assureraient à tout le monde une vie heureuse ; et il a révélé
son calcul et tout ce qui concerne le poison à l’homme qui pompe ».
Voyez,
au fur et à mesure que j’accumule les descriptions, l’homme pompe, il fait
toujours la même chose factuelle dans la nature : il baisse et lève son
bras en activant sa pompe.
« Certains
muscles aux noms connus des seuls docteurs se contractent et se relâchent…. Le
bras envoie une ombre sur un rocher, si bien qu’à un certain endroit, lorsqu il
arrive à une certaine position, il produit un effet curieux, comme si un visage
sortait du rocher…»
Je
vous laisse découvrir la suite de ce texte, mais vous voyez que, dès qu’on
attrape l’action par le biais de l’acte – est-il en train d’empoisonner des
gens ? Est-il en train de commettre un crime ? Est-il en train
d’empêcher une guerre mondiale ? Est-il en train de faire un truc rigolo
parce qu’il y a une ombre sur le rocher qui se dessine ? Est-il fasciné
par le bruit qu’il fait ? – tout ça, ce sont des descriptions équivalentes
que nous ne hiérarchisons qu’en fonction de nos attentes touchant la
transformation, imperceptible dans le langage, entre une description de
l’action et la caractérisation d’un acte. Et plus on avance dans
l’élargissement du contexte à l’intérieur duquel chacune des descriptions
s’insère, plus l’action change de sens et de valeur : ce qui était au
départ un acte ennuyeux devient un crime, ce qui était un crime devient le
salut de l’humanité, ce qui était le salut de l’humanité devient ensuite
quelque chose d’aussi dérisoire que de faire clic-clic avec une pompe.
Je
crois qu’il est donc extrêmement important de marquer combien l’action et
l’acte s’emboîtent l’un dans l’autre d’une manière qui nous suppose pris dans
le langage, dans le langage des autres, mais aussi dans le point de vue des
autres, dans le fait qu’il y a d’autres sujets et d’autres points de vue sur ce
que nous sommes entrain de faire. Ce qui introduit ici, vous y pensez bien,
l’idée de révisabilité radicale du contenu de toute notre existence.
Pour
prendre un point de psychopathologie directement articulé à cette analyse de
l’intention, Ian Hacking, dans son livre sur les personnalités multiples,
s’interroge sur ce que c’est que la mémoire, et sur ce qui se passe quand
quelqu’un d’un certain âge vient expliquer que lorsqu’elle était petite fille,
elle a subi des attouchements de la part de son père. Hacking dit :
faut-il se poser la question en se demandant s’il peut y avoir des souvenirs de
ce genre-là ? Est-ce quelque chose d’empiriquement possible ? N’y
a-t-il pas des manipulations de l’imaginaire, des déplacements, des
transformations qui lui font croire que… ? etc. Vous savez que plein de
psychanalystes ayant pignon sur rue s’imaginent que l’imaginaire est
susceptible de déformations particulières, et on peut à cette occasion vous
sortir une théorie lacanoïde des effets du signifiant sur les images mentales
avec des distorsions comme quoi ce n’est pas le papa, ce n’est pas ceci ou cela,
etc., mais du fantasme. Descendons juste un cran en dessous, au point où nous
sommes invités à considérer ce qu’est une action. Hacking fait remarquer que ce
n’est pas une question empirique. Est-ce que ce n’est pas plutôt une question
logique ? Le même geste change
de nature, selon la description qu’on lui donne. Et selon les moyens de
le décrire selon les signifiants disponibles à tel ou tel âge de la vie - avec
des effets qui ne sont pas des effets de rétroaction faramineux, des effets de
mémoire paradoxale -, mais selon tout simplement les signifiants qui sont
disponibles à un moment ou à un autre, le même geste peut être interprété des
années après comme étant un geste sexuel, alors que sur le moment il ne l’était
pas au sens où il sera sexuel après. Voyez qu’il y a là une dimension
importante de la synchronie, du point d’ancrage des signifiants du sexe par
exemple dans la reconstitution de ce que c’est que la sexualité infantile, qui
devrait mettre en garde sur la nature des actes tel qu’on en a le témoignage
dans une analyse, ou tel qu’on en a le « souvenir ». Est-ce qu’on
peut, donc, avoir le souvenir de tels actes, ou est-ce qu’on est pas tout
simplement en train de disposer d’une autre
manière de les décrire ? Ce qui déplace évidemment totalement le
problème d’une psychologie de la mémoire sur celui d’une analyse synchronique
des enjeux de la redescription. En tout cas, il est extrêmement important de
remarquer la grande thèse d’Anscombe, qui est évidemment l’ennemie absolue de
tout ce qui après a pu s’appeler cognitivisme – comme tous les autres élèves de
Wittgenstein -, c’est qu’il n’y a d’action que sous une description. La seule
manière d’isoler que ce mouvement-là est une action, c’est de le décrire comme
« pomper de l’eau dans un puits » avec toute sorte de choses qui font
de ce mouvement, non seulement une action par rapport à des intentions, mais un
acte qu’on puisse caractériser dans un espace symbolique avec des statuts et
des enjeux qui eux, ne sont pas dans la nature. C’est pourquoi - c’est
essentiel à noter, j’en parlerai abondamment cette année - la psychopathologie
cognitive de l’action se présente comme l’antithèse radicale de la psychanalyse et peut-être comme l’une des choses
qu’elle a le plus d’intérêt théoriquement à discuter pour faire valoir où se
trouvent les différences.
Je
termine ce point en parlant de l’éclipse limite de toute action qui est un des
enjeux je crois tout à fait profond de ce à quoi on aura à se confronter cette
année, dans un tout autre registre que celui de la philosophie, qui est le
dépaysement d’une autre civilisation. Je voudrai vous lire juste ce petit
passage de Lao-tseu :
« Le plus tendre en
ce monde domine le plus dur
Seul le rien s’insère
dans ce qui n’a pas de faille
A quoi je reconnais
l’efficace du non-agir.
L’enseignement sans
parole, l’efficace du non-agir,
Rien ne saurait les
égaler ».
Un
des paradigmes de l’acte au sens du non-agir – wu wei en chinois - sous la forme la plus radicalement étrange à
notre pensée, c’est celle du Tao, « le rien est la seule chose qui
s’insère là où il n’y a pas de faille », etc. Enormément de choses que
Lacan, à mots couverts, avance, sur l’objet (a), sur le champ de l’Autre, sur
l’acte de poser l’inconscient – est-ce qu’on le fait à une certaine heure, à un
certain moment ? – est imprégné de cette question très bien posée dans une
autre civilisation que la nôtre, et peut-être dans des termes que n’ont qu’une
vague ressemblance mais qui nous touchent, et qui sont ceux de la pensée
chinoise.
Je
voudrai maintenant me livrer à un petit commentaire de ce que j’ai mis au
tableau, parce que tout ce dont il me semble s’agir dans l’évolution de la
pensée de Lacan et du dégagement de son acte, c’est ça.
Difficulté
INHIBITION EMPECHEMENT EMBARRAS EMOTION
SYMPTOME PASSAGE A L’ACTE EMOI
ACTING OUT ANGOISSE Mouvement Comme
dans le paradoxe d’Anscombe, vous avez là une manière d’essayer de considérer
que l’acte est quelque chose qui serait susceptible d’être analysé comme des
descriptions de plus en « difficiles », fonction du contexte, de
la situation, de la richesse descriptive, et qui commandent la sélection d’un
« mouvement » dans la nature comme étant bien un acte. D’un côté
vous avez un mouvement, quelque chose de l’ordre du geste, du déplacement
physique du corps, voire de la sécrétion, et il y aurait une autre dimension,
une dimension orthogonale, qui serait l’augmentation progressive de la difficulté
du dit mouvement, mais non pas d’une difficulté parce que ça résiste physiquement,
mais parce que c’est difficile en fonction de la complication, de la richesse,
de la densité des repères symboliques à l’intérieur desquels ce mouvement
devient un acte. On pourrait se dire, après tout, que l’acte est quelque chose
qui se produit lorsque l’action est devenue tellement complexe, riche, articulée,
coordonnée, etc., qu’elle cesse d’être un simple déplacement matériel d’un
corps quelque part. C’est
difficile de se dispenser d’une représentation de ce genre, parce que l’inhibition
est effectivement par bien des aspects dans un corps humain quelque chose
qui retient ce corps. Car les gens ne peuvent décrire ce qu’est l’inhibition,
qu’en employant tout bêtement le vocabulaire de l’action, en disant qu’ils
ne peuvent pas, qu’ils n’y arrivent pas, que ça ne marche pas, comme s’ils ne pouvaient
pas arriver au terme d’un geste dont ils ont pourtant l’intention. Parce qu’on
en a bien besoin, pour penser la présence charnelle de ce qu’est l’inhibition
ou la paralysie hystérique qui est typiquement une fausse paralysie neurologique
mais où les gens sont absolument incapables de bouger tel membre. Ce n’est
pas pour rien que Freud part d’une conception neurologique de l’action en
se demandant ce qui peut être en jeu quand on n’a pas de lésion cérébrale,
pour que quelqu’un ne puisse pas faire une certaine action. Quant à l’angoisse,
avant d’en faire le concept métaphysique qu’il mérite tout à fait de devenir,
l’angoisse est un état somatique, quelque chose qui cède aux boissons chaudes,
aux couvertures, aux médicaments, etc., et on ne saurait oublier que l’angoisse
a des points d’ancrage neurologiques extrêmement forts au niveau de ce qu’on
appelle les « réactions catastrophiques » décrites par Goldstein
et la psychiatrie des traumatismes de guerre. Donc on ne peut pas se dépêtrer
facilement de la dimension naturelle, du point d’ancrage dans un corps avec
des effets sur le corps et de sa motricité, de ce qu’il en va de l’action.
D’ailleurs, quand Freud introduit la notion de l’inhibition, dans Inhibition,
Symptôme et Angoisse (ces termes décalés sur le schéma), eh bien il parle
de la locomotion, il parle littéralement de la capacité motrice des animaux ! Ce
schéma au tableau, qui n’est pas extrêmement populaire – j’ai même entendu
des gens, qui avaient connu Lacan, dire que c’était un truc bizarre -, je
vais essayer de lui donner un peu plus de sens. Et
comme j’ai parlé de déclaration d’amour, ce serait malheureux que de ne pas
entrer ici dans cette espèce d’ouverture du dispositif, en indiquant son point
d’entrée et – mais c’est une interprétation du schéma que je fais – en essayant
de rapporter ici le rapport ultime de cette ouverture particulière que l’angoisse
entretient avec l’expérience de l’orgasme. Comme ça on a l’impression d’aller
d’un point à un autre de façon pas trop insatisfaisante. Ce schéma, je ne
crois pas qu’il convient de le considérer comme une sorte de tabulation, mais
bien comme l’ouverture d’un espace à l’intérieur duquel les rapports de coincement
réciproques sont de plus en plus lâches, où se lit l’impression d’ouverture
progressive. Autrement dit, le symptôme ici, est une des sorties possibles
– sortie pivotante – permettant d’arriver à cette proximité particulière que
l’angoisse entretient avec l’orgasme. Alors, dans la direction si vous voulez,
du mouvement et de la progressive complexification de ce mouvement sous le
coup d’une difficulté croissante, Lacan a suggéré de raffiner énormément ce
qu’on entend en général par l’analyse de l’acte de quelqu’un, de ce qu’il
fait, de ce qu’il fait avec son corps, avec ses mouvements et avec ses émotions,
en indiquant bien que l’émotion est étymologiquement, c’est « é-motion »,
et en indiquant cependant quelque chose de tout à fait amusant à propos de
l’émoi, qui est juste, c’est que l’émoi n’a justement aucun rapport contrairement
à ce qu’on croit avec l’émotion. L’émoi, c’est le moment de l’impuissance.
« esmayer », dit-il, c’est perdre tous ses moyens. L’émoi est le
moment où l’on perd tous ses moyens. Autrement dit, c’est dans la dimension
de la motricité –sensible je crois dans ce qu’on appelle les « premiers
émois » - c’est le moment où l’on est le plus profondément troublé à
l’intérieur de la dimension motrice. Cet émoi a des manifestations symptomatiques
connues. Ça peut être par exemple l’émoi anal, le moment où au comble de l’expérience
du trouble de la motion amoureuse – et ce n’est pas qu’une description d’habitués
de bordel du 19ème siècle – le sujet en vient au moment critique
à la fois à être impuissant et à perdre une selle. Il y a une description
d’Aragon tout à fait frappante, dans Irène. Je vous ferais remarquer
ici qu’il y a quelque chose de l’ordre du lâchage d’objet, où l’objet qui
est lâché dans cet émoi-là, ce n’est pas les larmes, mais bien un excrément.
Une autre figure bien connue de cette sortie de l’inhibition, de l’émotion
et de l’émoi, c’est l’éjaculation précoce qui est un des lieux où la dimension
de l’émoi est la plus palpable. Ce n’est pas la dimension de l’émotion, c’est
le moment de l’impuissance, ou du trouble de la puissance du mouvement, lorsqu’on
est emporté. Et d’autre part, chose pour laquelle il est très important de
ne pas se tromper pour certains diagnostics, c’est l’évanouissement hystérique,
qui ne se produit pas du tout sous le coup de l’émotion, mais bien au contraire
qui est comme un lâchage du corps qui vient défaillir au moment où - et c’est
pour ça qu’on dit que ce sont souvent des équivalents orgasmiques -, au moment
où l’objet tombe dans cet axe. désir amoureux Difficulté
INHIBITION
EMPECHEMENT EMBARRAS EMOTION SYMPTOME PASSAGE A L’ACTE EMOI
ACTING OUT ANGOISSE L’empêchement
est effectivement quelque chose qui se distingue de l’inhibition dans la
mesure où Lacan, toujours en jouant sur les mots mais sans que ce soit idiot,
fait apparaître une difficulté particulière qui fait que l’empêchement est
lié au sentiment du piège. Ce que l’on appelle l’empêchement dans ce ralentissement
de l’acte ici, c’est l’expérience que quoi que vous fassiez – une chose
ou son contraire -, de toute façon vous êtes eu. C’est ça l’expérience de
l’empêchement. Elle suppose quelque chose comme une raison et une articulation assez sophistiquée du dispositif où vous
pouvez vous sentir empêché : je vais dans un sens et ça aboutit à ça,
je vais dans un autre et ça aboutit au même résultat. Autrement dit :
je suis piégé. On ne se situe donc non pas du côté du lâchage, mais véritablement
du côté du piège. Quant à l’embarras, il est la confrontation avec la plus
haute difficulté, non pas parce que ce
piège est un piège circonstanciel, mais parce que l’embarras est je crois
toujours la confrontation à la plus haute difficulté dans l’action. Et la
plus haute difficulté dans l’action, c’est très
simple, c’est quand quelque part s’y profile le fantasme. Il n’y a rien
de plus embarrassant pour un sujet, même quand il s’imagine être dans la
situation qu’il voulait, que de s’apercevoir que c’était finalement beaucoup
trop près de son fantasme, et qu’il risque tout simplement, lui, comme sujet, d’y disparaître. Vous avez là quelque chose qui n’est
pas l’angoisse, mais qui est la perception que le piège ultime est que vous
êtes piégé en tant que sujet dans
votre rapport à votre objet, et que le but, le terme de votre action est
simplement quelque chose qui vous confronte à ce qui était méconnu jusque-là,
qui était la cause de toute votre action, qui vous a amené là où vous ne
saviez pas que vous alliez arriver, et qui était la scène même du fantasme.
Et là, tout à coup on peut se trouver embarrassé de quelque chose que, justement,
on a complètement voulu et auquel on est allé en utilisant éventuellement
tous les moyens à sa disposition. L’équilibre
général de tout le dispositif, c’est pourquoi il est au centre me semble-t-il,
mais je spécule, c’est le symptôme. Un point d’équilibre - et c’est pour
ça que je le marque comme étant suspendu comme une sorte de moyen terme
-, qui permet de ne pas aller trop du côté du fantasme, de ne pas trop lâcher,
de ne pas être trop du côté de l’impulsion, du passage à l’acte et de l’inhibition.
Quelque chose vient - entre toutes ces dimensions plus ou moins problématiques
dans lequel ce qu’on veut faire se déplace - pour maintenir quelque chose. Quant
au passage à l’acte, à l’extrême difficulté qui correspond bien sûr à celle
de la confrontation du fantasme, c’est ce qui se passe dans l’embarras dont
on ne s’extrait dans la dimension du mouvement que par un franchissement
qui vous fait passer par la fenêtre de votre propre imaginaire, et qui vous
fait sortir du côté de ce qui jusqu’ici était entièrement retenu, et qui
est, très précisément, la cause du désir. Avec dans cette perspective-là
un point qui est certainement de tous le plus lâche, le moins tenu dans
sa proximité à cette ouverture progressive du spectre de la manifestation
de l’acte, qui est l’angoisse. L’acting out que j’ai mis ici, et qui est
une notion extrêmement particulière, et dont la définition psychanalytique
est très longue, s’insère dans ce schéma si vous tenez compte du fait qu’il
s’agit précisément de cet objet qui est lâché dans l’émoi, lâché purement
et simplement, mais pas comme l’obsessionnel qui au moment de l’émoi amoureux
le plus intense se souille, mais lâché en tant que mis en scène, en tant
qu’il est monté sur la scène, éventuellement d’ailleurs à la place du sujet
– ce qui fait qu’il est assez difficile en réalité de distinguer acting out et passage à l’acte quand on n’a que les réalités apparentes
– comme une volonté de se reconnaître et de se faire reconnaître dans son
désir là où son désir a été malheureusement actionné, souvent par une interprétation
plus ou moins malheureuse du psychanalyste, avec cette dimension du « monté
sur la scène », de la monstration, de ce qu’il en est là où ça aurait
pu être quelque chose comme « déchoir », tomber radicalement.
Alors évidemment, tout ceci se fait dans le langage du symptôme, comme le patient de Kris, après qu’il lui ait
fait remarquer qu’il n’est pas vraiment plagiaire parce que, ayant lu les
bouquins que son patient déclarait plagier, il considère qu’il ne s’agit
pas de plagiat. Dite de cette façon, l’interprétation est à peine moins
calamiteuse que ce qui est raconté, et alors le patient sort, entre dans
un restaurant, et commande un plat de cervelles. Et il bouffe ces cervelles
avec un appétit extraordinaire. Voyez, c’est quand même dans le langage
que tout se passe : - si je ne
peux pas être le plagiaire dans ce sens-là, celui qui pique la pensée des
autres et qui se sustente des produits de la tête des autres, alors je vais
l’être dans un autre sens, avec une sorte de monstration de ce qui a
été méconnu et fort malheureusement actionné par une interprétation. L’angoisse,
et je maintiens ce point, a ici les plus étroits rapports avec l’orgasme.
Je ne vous citerai pas l’exemple bien connu où le moment de rendre la copie
lors d’un examen s’accompagne d’une jouissance sexuelle inopinée complètement
surprenante et désarçonnante au point le plus extrême de l’angoisse :
c’est précisément où l’on rend une copie blanche, donc au moment où l’acte
s’avère être entièrement nul, que d’une manière inopinée, c’est–à-dire avec
une surprise, dans le lâchage de ce type d’objet, tout à coup, une jouissance
sexuelle se déclenche. Ça caractérise je crois au mieux, sur la ligne du
bas, combien il s’agit en fait dans l’orgasme, dont il n’y a pas lieu de
s’imaginer qu’il devrait être systématiquement voluptueux – c’est bien le
cas avec ce type d’orgasmes qui sont en général extraordinairement anxiogènes,
vécu sans plaisir alors même qu’il s’agit bien de la décharge physiologique
de l’angoisse, identifiée comme telle -, que ce qui est cédé par le sujet
ne concerne pas simplement les objets comme les excréments par exemple,
mais véritablement quelque chose qui dans son rapport à l’Autre est la cause
même de son désir. Et ce exactement à quoi l’angoisse confronte chacun,
c’est d’être appelé par la cause de son désir, et de l’être presque
comme si c’était une voix. C’est-à-dire que ça appelle le sujet et ça le
saisit d’une manière telle qu’il ne saurait plus du tout s’en débarrasser.
Lacan spécule d’une façon curieuse mais je crois significative en disant
que de toute façon l’expérience de l’orgasme est l’expérience du « survivre
à l’angoisse ». A cet égard, on voit pourquoi un certain nombre de
déclenchement des psychoses est vraiment lié au premier rapport sexuel et
non pas au désir, qui peut être emballé dans un semblant et particulièrement
bien contenu, mais bien à une expérience de l’orgasme d’une intensité qui
suffit à faire lâcher au sujet quelque chose qu’il n’est pas équipé pour
retenir, d’aucune manière. Dans un des cas cliniques que j’aborderai cette
année, on verra que ce sont toujours des expériences d’orgasme, et non pas
des expériences de désir, qui sont des déclenchants d’angoisses schizophréniques
paroxystiques qui mettent par terre tout l’édifice de ce qu’on essaie par
ailleurs dans une analyse de faire tenir chez quelqu’un. Et la corrélation
ici, de l’angoisse et de l’orgasme est parfaitement claire. désir amoureux Difficulté
INHIBITION
EMPECHEMENT EMBARRAS sentiment de piège fantasme EMOTION
SYMPTOME PASSAGE A L’ACTE point d’équilibre EMOI
ACTING OUT ANGOISSE
Tout
ce schéma, tel que je vous propose de le lire, du désir amoureux à l’orgasme,
et tout ce qui est impliqué dans la conjonction du côté action impliquant
une motricité, impliquant du corps, et en même temps du côté de l’acte,
c’est-à-dire une inscription symbolique, est à rapporter au ravage de l’objet (a) dans le désir amoureux.
C’est ce travail de tenue et de disjonction de l’objet cause du désir qui est entièrement impliqué ici. Et ce qui est
impliqué, c’est pour ça que j’ai pris l’exemple du désir amoureux, c’est
que ce qui mobilise l’angoisse ici, c’est le travail de cet objet de l’angoisse
dans la confrontation sexuelle, au sens où justement il n’y a toute cette
construction que parce qu’il n’y a pas de rapport sexuel, et parce
que l’acte vient ici dans tout ce qui s’ouvre comme perspective inscrire
dans la réalité quelque chose de ce non rapport. Et ce sont donc des points
d’achoppement qui contaminent l’acte et l’action à égalité. Je
montrerai comme je pourrai, à partir d’un autre cas clinique que j’examinerai
cette année, comment Lacan a pu appliquer ce schéma à la névrose obsessionnelle,
c’est-à-dire comment il y a une interprétation rigoureuse, et je crois
très parlante, et qui est un vrai progrès par rapport à ce qui est l’agencement
structurel particulier des symptômes de la névrose obsessionnelle, lorsqu’on
en pense les phénomènes à travers ce schéma, et lorsque par exemple on
essaie de coordonner – les passages à l’acte sont rares dans la névrose
obsessionnelle, mais en général ils portent sur quelque chose qui est
de l’ordre de l’idéation suicidaire - ce que j’ai raconté de l’émoi, de
l’inhibition qui est un des phénomènes majeurs de la névrose obsessionnelle,
de l’angoisse, et comment à partir de ce type de schéma, à partir de la
confrontation du désir amoureux à la différence sexuelle et à l’Autre,
celui qui souffre par excellence d’une pathologie de l’action, d’un empêchement,
d’une inhibition, d’un embarras, de symptômes, avec des acting
out particuliers et des idées suicidaires torturantes, qui est l’obsédé,
comment l’ensemble de tous ces phénomènes peut être authentiquement coordonné.
Ça permettra si vous voulez, c’est un peu ce que je me propose, de confronter
ce que Freud pense de l’obsédé à travers son paradigme de l’action, qui
est un paradigme neurophysiologique dans son essence, qu’il tord comme
il peut pour essayer d’attraper la dimension morale, la dimension éthique
qui évidemment n’existe pas dans la motricité mais uniquement dans les
modalités descriptives des actions. Lever le bras, selon les descriptions
d’Anscombe, c’est éthiquement neutre, d’autres fois c’est horriblement
mal, et d’autres fois c’est extraordinairement bien. C’est-à-dire que
le bien, le mal ou la neutralité dépendent des modalités descriptives.
Donc Freud est très embarrassé pour attraper la dimension éthique de l’acte
dans son paradigme de la description. Et pourtant, il s’y cramponne, puisqu’on
a affaire à des gens qui ont des compulsions, qui décrivent en tout cas
dans leur imaginaire la lutte anxieuse - est-ce
que je vais résister à la tentation de prendre le couteau qui est sur
la table et de filer un coup de couteau à telle ou telle personne ?
- comme quelque chose qui est littéralement un problème de contrôle
musculaire. Et il n’est pas rare d’avoir des gens avec des crispations
de la mâchoire, voire des tétanies tellement la lutte anxieuse peut s’incarner
dans la motricité même de l’obsédé en crise. Je
confronterai donc ce que Freud essaie d’attraper avec son paradigme de
l’action avec ce qu’on peut attraper peut-être de plus fin à travers ce
paradigme extrêmement problématique et délicat de l’acte chez Lacan. Je
vais conclure en essayant de radicaliser le problème que j’aimerai poser
cette année, qui consiste à essayer de penser les effets - qui sont des
effets objectivés, qui ont une teneur psychopathologique dans un champ
qu’on peut décrire en psychiatrie - les effets d’un désir alors même que
ce désir se maintient, lui, ineffectué. Voilà je crois le point
de tension le plus élevé auquel on arrivera. Parce que je crois que si
nous voulons parler de quelque chose en psychanalyse et mettre en question
ce qu’il en est de l’acte, ce qu’il en est non seulement de l’efficience
de l’acte, l’efficience étant justement le maintient ineffectué
de la cause, et ce qui est de l’efficacité de l’acte - au moment où la
cause est entièrement passée comme puissance déterminante dans son effet
-, la distinction de l’efficience et de l’efficacité, l’acte analytique
est bien obligé de se poser la question de savoir ce qu’il peut contre
des symptômes objectifs, et pourquoi en même temps, même s’il peut quelque chose contre des symptômes objectifs, le fait de poser
l’inconscient maintient une autre
dimension, et appelle le sujet sur un autre plan que celui de la simple
– vous me direz que c’est déjà beaucoup - sédation de ses symptômes. Alors,
je ne sais pas très bien comment mieux le marquer, mais il est absolument
essentiel de maintenir les deux dimensions, c’est-à-dire d’avoir à répondre
de ce qu’il y a d’objectif dans le symptôme, tout en maintenant le primat
de l’acte sur l’action. Ce qui engage au fond ce qu’on peut dire d’un
sujet ce qui serait autre chose qu’un corps empêché d’agir, selon des
normes sociales ou naturelles, peu importe, mais qui seraient au fond
des normes tout à fait extérieures à ce qui est en cause dans un acte. Je
le fais avec d’autant plus de force qu’il est facile de se contenter de
situer les choses dans le registre de l’acte, en oubliant que Freud, lui,
ne s’en est pas du tout contenté. Car il a effectivement tenté de donner
une caractérisation à travers le paradigme de l’action de ce qu’était
l’action de la levée du refoulement, comment on pouvait penser que des
représentations puissent, une fois le refoulement levé, caractériser la
levée d’un symptôme. La prochaine fois, je vais donc m’engager dans une
exploration que j’ai déjà faite dans mon commentaire sur la Traumdeutung,
mais sur laquelle je voudrais revenir, sur le paradigme de l’action chez
Freud. Car je crois qu’il faut à un moment qu’on se rappelle clairement
comment Freud peut écrire une chose comme « le rêve remplace l’action »,
comment il se représente les choses, et comment à partir de l’action il
essaie de rejoindre le pôle de l’acte. De façon, et c’est là que dans
une autre séance j’essaierai de travailler sur la névrose obsessionnelle
comme étant la pathologie où ces questions se posent le plus fortement,
que nous comprenions ce qui se passe entre Freud et Lacan sur une situation
clinique. Je vous apporterai un cas sur ce sujet. J’essaierai
aussi de prendre les choses dans l’autre sens, c’est-à-dire : lorsqu’on
met l’accent sur l’acte psychanalytique,
sur ce que fait l’analyste en tant qu’il pose l’inconscient, de quel acte s’agit-il ? Car on est bien
obligé de caractériser cet acte. Par exemple la déclaration d’amour. Mais
je prendrai aussi l’exemple de la « déclaration d’intention ».
Et puis on abordera même à travers un texte de Kant ce qu’il en est de
l’acte révolutionnaire. Une
des choses enfin qui est délicate lorsqu’on veut distinguer l’acte de
l’action, c’est que l’action a une rationalité. Cette rationalité, je
vous renvoie à Anscombe, c’est ce qu’on appelle le syllogisme pratique
sur lequel elle dit les choses les plus profondes. Y a-t-il une logique
de l’acte qui remplisse les mêmes fonctions que cette analyse très
particulière, qui remonte à Aristote, de ce qu’est la logique de l’action,
et qui chez Aristote a la forme d’un syllogisme ? Lacan, qui prend
les choses à leur degré de radicalité philosophique, propose effectivement
une sorte de distorsion particulière du syllogisme pratique pour penser
cette logique de l’acte. Et
puis, ça nous conduit à ce qui est la grande difficulté, la question éthique.
C’est-à-dire que les actions sont neutres, tandis que parler d’acte, c’est
immédiatement faire référence à la question éthique. L’acte, à ce moment-là,
j’en avais parlé l’an dernier pour la perversion, pose la question du
mal. C’est seulement à partir de l’acte que se pose la question du mal.
Et on pourrait dire que c’est donc seulement à partir du mal que la question
du désir devient effectivement une question sérieuse. C’est tout à fait
autre chose bien sûr que de considérer le désir comme une motivation :
- pourquoi as-tu fait ça ? - Parce que j’en avais envie…On peut
utiliser le mot de désir pour motiver une action : - je croyais ceci, j’avais envie de ça, voilà
ce que j’ai fait ! C’est une explication. Mais bien évidemment,
si vous êtes dans le domaine de l’acte, alors vous allez êtes confronté
à la question de ce que c’est que le désir du mal. Je termine ce soir
là-dessus en vous laissant sur ces perspectives, et en vous donnant rendez-vous
au 23 octobre, parce que le 30, c’est les vacances. X : j’ai l’impression qu’on aurait beaucoup de mal à penser le
corrélatif de ce tableau pour ce qui concerne la facilité. Et je me demande
si ça a une raison particulière. J’ai l’impression que ça n’a aucun sens
de penser terme à terme les équivalences, et je me demande pourquoi. P-H. Castel : parce
que je pense que c’est un analyseur, en tout cas moi je le prends comme
une manière d’analyser la confrontation à l’autre sexe. Soit on
se contente d’une description de type phénoménale ou littéraire, en disant
que ça coince jusqu’à un certain point, et puis qu’ensuite ça se décoince
– pleins d’écrivains superficiels se contentent de raconter comment ça
coince et comment ça se décoince -, soit et c’est l’intérêt de ce que
le divan apprend, on repère qu’il existe un certain nombre de choses qui
sont en cause et qui sont de nature tout à fait distinctes, et qui supposent
justement que l’acte du rapport sexuel, là où d’une certaine manière l’altérité
à laquelle on se confronte est une altérité infiniment problématique,
eh bien ouvre un espace de dérapages possibles, mais situés les uns par
rapport aux autres, qui ont une nécessité structurale. Donc effectivement,
il n’y a pas d’acte (sexuel) facile. L’acte implique quelque chose de
l’ordre de la difficulté. Qu’il implique de troubler le mouvement, c’est
extrêmement sensible, particulièrement dans la vie érotique. Et donc les
dimensions qui font qu’au fond ça achoppe sur la dimension de l’angoisse
et de l’orgasme sont importantes. C’est ce qui est très puissant à mon
avis dans l’analyse de Lacan. Les gens qui me racontaient ce schéma me
disaient que ça avait l’air d’être totalement brouillon dans sa tête,
et c’était donc quelque chose qui leur avait paru entièrement de circonstance
et pas du tout appelé à avoir une consistance forte. Et ce que je vous
fais là, je n’ai jamais vu d’analyste qui lui donne ce poids. Ce qui est
important, c’est que si vous le pensez dans la détermination du transfert,
ça vous permet de penser le passage à l’acte et l’acting
out. J’avais
justement le projet de mêler à ces considérations d’analyse clinique le
cas d’une patiente qui fait des passages à l’acte sur le mode d’auto-intoxication
alcoolique dont elle ressort avec de véritables trous noirs et avec un
syndrome persécutif relativement important qui a plusieurs fois motivé
son hospitalisation, parce qu’il lui arrive manifestement sexuellement
des choses. Il est important de pouvoir voir, lorsqu’on est sur un pôle
de transfert psychotique, où sont les différentes dimensions et comment
elles s’articulent les unes aux autres, et ce qu’il est peut-être possible
quelque fois de faire, non pas pour prévenir les passages à l’acte, mais
pour essayer de déplacer le sujet d’une trajectoire où le passage à l’acte
pourrait après tout être évitable. Si l’on n’a pas de « carte »,
c’est toujours ce que je vous dis à propos de la topologie chez Lacan,
nous en sommes réduit à l’empirique. Donc il vaut mieux avoir une carte
fausse parce qu’on peut toujours essayer de la corriger que de laisser
son propre acte non éclairé. Il y a donc le rapport à l’autre sexe, mais
il y a aussi je crois le rapport à l’Autre dans le transfert, dans ce
schéma.